Accueil > La démocratie au pied de la lettre : De quoi Sarkozy est-il le nom ?
La démocratie au pied de la lettre : De quoi Sarkozy est-il le nom ?
Publie le vendredi 23 novembre 2007 par Open-Publishing1 commentaire
« De quoi Sarkozy est-il le nom ? »
La démocratie au pied de la lettre

Nous savons désormais que l’élection que N. Sarkozy ne fut pas un accident. « Dans six mois », disait-on (pour s’en plaindre ou s’en réjouir), « cela aura l’air moins grave » : le temps devait arrondir les angles et la fonction légitimer l’homme. Les mois sont passés, et cette très mauvaise surprise n’est plus une surprise : rien ne s’est estompé, bien au contraire. Comprendre pourquoi, c’est percer à jour le véritable événement masqué par la personne du président. « Ce vote, qui ne fait que nommer la venue de la chose immonde à l’ordre du jour, a toute la structure d’un coup attendu. » C’est le philosophe Alain Badiou qui écrit cela, dans son essai « De quoi Sarkozy est-il le nom ? ».
Si ce petit livre s’est assuré, en quelques semaines, un si grand retentissement, c’est qu’il formule correctement la question qui nous préoccupe, et qui n’est plus de savoir « qui est vraiment N. Sarkozy » (ça, tout le monde le savait [1] et chacun est responsable en conséquence), mais bien plutôt : que signifie son élection. Alain Badiou nous propose d’abord de disséquer un sentiment (« ce qui vous déprime, c’est ce dont Sarkozy est le nom. Voilà de quoi nous retenir : la venue de ce dont Sakozy est le nom, vous la ressentez comme un coup que cette chose vous porte, la chose probablement immonde dont le petit Sarkozy est le serviteur. » p. 28). Ce qui nous déprime, c’est de ressentir d’abord cette évidence contradictoire : Nicolas Sarkozy d’une part est le pur produit de la démocratie, et de ce qu’elle peut avoir de vicié, d’irrationnel (seule une démocratie à son paroxysme peut élire un tel démagogue). Mais d’autre part, nous voyons bien que ce qui nous dérange dans son élection est bien qu’elle est le résultat d’une offensive réactionnaire de restauration politique fondamentalement anti-démocratique. Comment penser cette contradiction ? D’abord en revendiquant, dans notre compréhension de la démocratie, la différence qu’il ne faut jamais cesser de faire entre son esprit et sa lettre. « Les juristes le savent, la règle trouve son équilibre dans l’esprit de la règle et non dans sa lettre. Elle vit d’être interprétée, ouverte, ou bien elle ne vit plus. Et, ne vivant plus, elle étouffe et devient meurtrière. Les violents sont toujours fondamentalistes, ils n’interprètent jamais la loi. Ils lui obéissent à la lettre, pour enquiquiner le monde en toute quiétude. Ils font du zèle, ils prennent tout au pied de la lettre, sans recul, sans humour, pour piéger leurs adversaires. » (Bertrand Vergely) [2] L’un des discours les plus fréquents depuis l’élection de N. Sarkozy n’est-il pas d’affirmer que, massivement élu, il n’y a plus aucune légitimité à s’opposer à son action, sauf à fouler aux pieds le scrutin démocratique ? Et n’est-ce pas précisément cet argument qui est avancé aujourd’hui constamment dans la rhétorique merdoyante des contempteurs de la grève ?
Pour être vivante, une démocratie
doit produire de la démocratie.
Hélas pour eux, ce qui vaut pour la loi vaut pour la démocratie : elle vit d’être interprétée, ouverte et de ne pas être prise au pied de la lettre. Voilà ce qui explique le malaise, le sentiment de déprime : l’élection de N. Sarkozy, c’est la victoire de la démocratie prise à la lettre, et c’est la défaite de la démocratie comprise dans son esprit. L’ayant bien saisi, Alain Badiou structure la première question de son essai sur cette rupture entre la forme de la démocratie et son contenu : « Si le nombre exige à lui seul qu’on le célèbre, alors cela veut dire que la démocratie est strictement indifférente à tout contenu. » (p. 41) Ce qui signifie que pour être vivante, une démocratie doit produire de la démocratie. Si une démocratie produit de la tyrannie, de la dictature ou un régime hybride qui relègue la politique à n’être rien de plus que l’un des rouages d’un système de féodalités économiques, alors nous ne sommes plus dans un régime fondé par l’esprit de la démocratie mais par sa lettre.
Pour bien saisir ce que signifie produire de la démocratie, il faut revenir au sens du mot : la démocratie, c’est-à-dire la souveraineté au peuple. Alain Badiou note que ce sens s’accorde mal, à l’expérience, avec le fait de présenter comme indiscutable tout ce qui est désigné arbitrairement par la majorité du suffrage universel. La participation massive souvent invoquée par les partisans de N. Sarkozy lui inspire ce sarcasme : « Par leur nombre stupide, ils ont fait triompher la démocratie (...) Le suffrage universel serait la seule chose qu’on aurait à respecter indépendamment de ce qu’il produit ? Et pourquoi donc ? » (p. 41). Le sarcasme recèle pourtant ici une vérité : la souveraineté populaire est une fin dont le suffrage universel ne doit être que le moyen. Que l’on inverse ce principe, et l’on érige un système qui n’est plus qu’une vassalité populaire légitimée par l’assentiment du plus grand nombre. Une démocratie la tête à l’envers, si l’on veut : « Pourquoi diable 51% des Français seraient-ils « les » Français ? N’est-il pas constant dans l’Histoire, comme par exemple au moment crucial de l’occupation allemande, que « les Français », c’est bien plutôt la toute petite minorité de Résistants, en fait, pendant au moins deux ans, trois pelés et un tondu ? Les autres sont largement pétainistes, ce qui veut dire, dans les conditions de l’époque, non pas du tout « Français », mais serviteurs peureux de l’Allemagne nazie. »
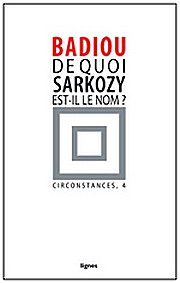
Alain Badiou
« De quoi Sarkozy est-il le nom ? » [3]
Un tel constat implique l’idée (qui peut inquiéter mais que nous devons aujourd’hui régénérer à fond [4]) que la démocratie authentique n’est pas, contrairement à ce que le discours dominant voudrait faire croire, une idée modérée. Lorsque l’on détourne le projet démocratique de son cours pour le transformer en régime intermédiaire, en régime hybride, en synthèse impossible de la lutte restauration/progrès, on peut être certain que l’indécision finira par profiter fatalement à la réaction et au recul social. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la maxime de Saint-Just : « Ce qui constitue la République, c’est la destruction totale de ce qui lui est opposé. » N’en déplaise à feu Alain Madelin et à ses nouveaux disciples, il n’y a pas de démocratie libérale. Un régime est démocratique — ou bien il est libéral. Le pouvoir est au peuple, ou bien au marché. Il faut choisir. Et le chiffre médiocratique de « 51% » traduit à merveille la notion d’hésitation, d’option fragile, de paralysie de la décision qui est sans doute l’inverse de ce que Rousseau nommait la volonté générale [5]. La litanie qui découle de ce chiffre magique devient ainsi l’arme d’une force de réaction à laquelle il avait fallu pourtant arracher par la terreur le commencement d’un processus démocratique, ce qui ne fait qu’aggraver la déprime évoquée plus haut : « C’est un trait caractéristique de la France justement : quand la question de son existence est réellement en jeu, ce qui la constitue, sur un fond réactionnaire et peureux fort épais, est une minorité aussi active que numériquement très faible. Notre pays n’a existé et n’existera, quelle qu’en soit la forme à venir, que par ceux qui n’ont pas consenti aux abaissements qu’exige universellement la logique de la survie des privilèges, ou même la simple conformité « réaliste » aux lois du monde. Ce sont ceux-là qui ont choisi, et ce n’est certes pas en votant. » (p. 22)
Une politique qui refuse
ce postulat : « ceux qui sont ici sont d’ici »
s’apparente à du colonialisme sur place.
Osons une formule-choc : la démocratie est une idée « totalitaire ». Et pourquoi non ? N’y a-t-il pas moyen de trouver à ce mot un sens vigoureux qui n’évoque pas immédiatement la brutalité, la dictature et l’oppression ? N’y a-t-il pas quelque chose de positivement totalitaire dans le fait de considérer que tout le monde compte, que tout le monde a son mot à dire, et qu’il convient de rejeter farouchement une société qui aurait besoin, pour fonctionner, d’exclure du champ politique une partie (plus ou moins grande) de sa population ? Totalitaire, c’est justement cela : qui englobe la totalité, sans exception, sans exclusion. C’est précisément cette idée de la démocratie que la sarkozysme ronge comme un acide : tout le monde ne compte pas de la même façon, on récuse l’idée de totalité nationale, pour lui substituer celle d’identité nationale. Et cette façon d’affirmer l’identité, écrit Badiou, est négative : « Elle consiste à défendre avec acharnement que je ne suis pas l’autre. Et c’est souvent indispensable, par exemple quand Sarkozy exige une intégration autoritaire. » (p. 88).
Exit donc le principe de la souveraineté populaire, c’est à dire l’esprit de la démocratie, qui, pleinement comprise, impliquait ce postulat : « ceux qui sont ici sont d’ici ». Un renversement logique est opéré, sont d’ici, désormais, ceux qui prêtent allégeance à une règle identitaire qui repose sur un principe d’escamotage violent : l’identité nationale n’est pas déduite a posteriori par la somme ou la synthèse des individus (et de leurs cultures) présents de fait sur le territoire - elle est au contraire la culture qu’une partie de la population, mystérieusement propriétaire du pays, impose de droit à tous les autres habitants. C’est ainsi que l’étranger, et toute la mythologie qui lui est associée [6], incarne un puissant (et réel) potentiel de transformation politique qu’il s’agit d’exorciser par tous les moyens - y compris la traque, les rafles, la menace constante d’une arrestation, d’une rétention, qui constituent aussi un chatiment spectaculaire à l’impardonnable puissance politique qu’il représente : « Sur ce lien intime entre la politique et la question des étrangers, aujourd’hui absolument central, il y a un texte étonnant de Platon. C’est à la fin du livre IX de La République. Les jeunes interlocuteurs de Socrate lui disent : « Ce que tu nous a raconté, là, sur la politique, c’est très bien, mais c’est impossible. On ne peut pas le réaliser. » Et Socrate répond : « Oui, dans la Cité où l’on est né, c’est peut-être impossible. Mais ce sera peut-être possible dans une cité étrangère. » Comme si toute politique vraie supposait l’expatriation, l’exil, l’étrangeté. Souvenons-nous de cela quand nous allons faire de la politique avec des étudiants venus d’ailleurs, des ouvriers des foyers, des jeunes des banlieues : Socrate a raison, le fait qu’ils soient étrangers, ou que leur culture soit différente, n’est pas un obstacle. Au contraire ! La réalisation d’une politique vraie en un lieu de ce monde unique que nous proclamons a absolument besoin, pour sa possibilité même, de ceux qui viennent d’ailleurs. » (p. 93)

Non seulement on rafle...
...mais on voudrait de surcroît prohiber l’usage du mot « rafle ».
Proclamer, à l’inverse, que la vie en commun implique une intégration à sens unique consiste à amalgamer sciemment le territoire et un ensemble de valeurs stratégiquement posées comme indiscutables. Il n’est pas exagéré de qualifier une telle politique de colonialisme sur place. Or, ce n’est pas le territoire qui forge les hommes, mais bien les hommes qui font leur territoire ; ainsi une construction politique qui, au contraire, rejette toute distinction entre être ici et être d’ici crée les conditions d’une démocratie pleinement comprise, dans laquelle, par exemple, « l’ouvrier marocain ne va pas abandonner ce qui fait son identité individuelle, familiale ou collective. Mais il va peu à peu approprier tout cela, de façon créatrice, au lieu où il se trouve dans le monde. Il va ainsi inventer ce qu’il est : un ouvrier marocain à Paris. On peut dire qu’il va se créer lui-même comme mouvement subjectif, depuis le paysan marocain du Nord jusqu’à l’ouvrier installé en France. Sans cassure intime. Mais par une dilatation de l’identité. » (p. 88) Le raisonnement inverse, qui voudrait que l’autre soit un principe de corruption contre lequel il faut se protéger - à tout prix - correspond à une idéologie dont Alain Badiou va donner une définition pleine et large, qu’il fait remonter à la Restauration de 1815 : « le pétainisme comme transcendantal de la France ».
Chaque nouveau mouvement de Restauration
aimerait en finir un bonne fois pour toutes
avec le spectre révolutionnaire de la justice sociale.
Pétainisme : le mot est lâché et l’on voit déjà les foudres à l’horizon. Pourtant, ne renonçons pas à la définition qui nous est offerte ici. On nous accusera de manier l’amalgame, alors que la définition que donne A. Badiou du pétainisme relève au contraire d’un travail de discernement, de démaillotage : le pétainisme, ce n’est pas seulement Pétain. C’est cette chose dont Pétain est l’incarnation la plus précise. Et cette chose, c’est l’effort continu contre lequel se brise l’aspiration révolutionnaire depuis son avènement : le Restauration. Pour bien comprendre ce contre quoi lutte inlassablement et sous une multitude de formes l’idéologie de la Restauration, prenons un exemple historique. Dans un rapport au nom du Comité de salut public, présenté à la Convention nationale le 13 ventôse an II, Saint-Just propose que toutes les communes de la République dressent une liste des patriotes nécessiteux, avec leurs noms, leur âge, le nombre et l’âge de leurs enfants. « Lorsque le comité de salut public aura reçu ces états, il fera un rapport sur les moyens d’indemniser tous les malheureux avec les biens des ennemis de la révolution. » [7] Une telle portée de l’organisation politique dépasse le fait révolutionnaire original et surplombe toutes les aspirations démocratiques pleinement revendiquées. C’est la même idée qui motive le décret, adopté le 25 avril 1871 par la Commune de Paris, ordonnant de réquisitionner les logements vacants. Idée que l’on retrouve encore dans le programme du Conseil National de la Résistance, adopté en 1944, et qui prévoit « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie » [8]. En mai 68, on pouvait entendre ce slogan : « On ne revendiquera rien, on ne demandera rien. On prendra, on occupera. » Et aujourd’hui, une association comme « Droit Au Logement » milite quotidiennement pour obtenir la réquisition d’office des logements vides pour les personnes sans abri [9].
Pour Alain Badiou, cette intransigeance dans la volonté d’instaurer une justice sociale constitue la force motrice du projet démocratique pleinement élaboré. Par sa permanence, ses formes multiples (Révolutions, Commune de Paris, Communisme originaire, Front populaire, Résistance...) et sa longévité, il incarne la réalité historique de ce spectre qui hante l’Europe dont parlent Marx et Engels. La présence de ce spectre qui promet de renverser l’ordre ancien génère une réaction peureuse (et même panique) qui se solde finalement par ce compromis avec le tyran : « Faites tout ce que vous voulez, du moment que vous nous protégez du moindre risque de désordre » ; ce qui a pu se traduire, à une époque encore proche par un “bon mot” autrement plus glacial : « Hitler vaut mieux que le Front Populaire ». Alain Badiou note que par-delà la formule, on retrouve dans une telle demande une caractéristique constante et fondamentale du dispositif pétainiste : « la propagande selon laquelle, cristallisant et aggravant la crise morale, il s’est passé, il y a peu de temps, quelque chose de néfaste. C’est un point capital. La propagande pétainiste consiste largement à dire qu’à l’origine de la crise morale et du déclin, il y a un événement désastreux, toujours lié à des revendications populaires. Dans le cas des pétainistes de la Restauration, en 1815, c’était évidemment la Révolution, la Terreur, la décapitation du roi. Dans le cas du pétainisme de Pétain, ce désastre est le Front populaire. Le gouvernement Léon Blum, c’était quatre ans avant, et de même, surtout, les grandes grèves avec occupation des usines. Ces désordres inqualifiables avaient flanqué une trouille mémorable aux possédants de ce pays. Ils en tremblaient encore. Ils préféraient de loin les Allemands, les nazis, n’importe qui, au Front populaire. » (p. 111)

14 juillet 1936 - Photo : Willy Ronis
Fille de cheminot, Susanne T. avait 7 ans.
Elle porte le bonnet phrygien que lui avait confectionné sa mère.
Chaque nouveau moment de Restauration aimerait en finir un bonne fois pour toutes avec le spectre révolutionnaire de la justice sociale. C’est une lutte à mort qui n’a pas encore connu son vainqueur, certes, mais une lutte à mort tout de même. Voilà pourquoi nous avons dit plus haut que la synthèse impossible de la lutte restauration/progrès, finissait par profiter fatalement à la réaction et au recul social. Compris dans ce sens, le phénomène Bayrou de l’élection présidentielle de 2007 est bien (comme peu l’ont vu) un symptôme du sarkozysme, et non pas (comme beaucoup ont voulu le voir), une alternative au sarkozysme. La Restauration dont Sarkozy est le nom exige elle aussi « que soit publiquement et unanimement reconnue la disparition du spectre. » (p. 51) Et tout comme le régime de Vichy tenta en vain de faire passer le Front populaire pour responsable de la défaite française face à l’Allemagne nazie, le sarkozysme recycle cette fiction avec les événements plus récents de l’histoire des conquêtes sociales. Le Front populaire de Sarkozy, c’est Mai-68, ce qui explique la violence rhétorique déployée “contre les héritiers de 68” [10] De ce constat, Alain Badiou conclut qu’on ne saurait combattre le sarkozysme avec de simples arguments, ou dans un « dialogue » qui consisterait à discuter les défenseurs des idées qu’il incarne.
Lutter contre cette incarnation actuelle de la Restauration provient d’abord d’un mouvement de dégoût, de rejet physique : les Résistants n’étaient pas des fonctionnaires de Vichy qui souhaitaient aménager le pétainisme pour en adoucir les principes, mais « le courage, qui est celui de la Résistance, c’est tenir un point absolument hétérogène au pétainisme. Si “pétainisme” désigne le transcendantal des abjections possibles de notre pays, l’invariant logique de sa corruption, tout courage est le courage de ne pas être pétainiste. C’est la définition la plus restreinte. Après tout, c’est la définition du courage de la Résistance proprement dite, avant 1944 en tout cas. Le choix d’entrer dans la Résistance était le choix du point réel que le courage devait tenir, dans un élément qui était une complète opposition au pétainisme. Etre contre le nazisme et l’occupation ne suffisait pas pour entrer en Résistance. Il y fallait le dégoût du pétainisme, infection proprement nationale de la subjectivité. » (p. 125) Formulons-le ainsi : on ne peut pas être « à moitié contre » le sarkozysme. La radicalité de ce dont Sarkozy est le nom représente ainsi une chance concrète qu’il s’agit de saisir sans délai : celle d’opposer à la droite décomplexée, une gauche sans complexe. Ce qui semblait encore utopique sous Jospin ou Chirac, devient paradoxalement indispensable sous Sarkozy. La violence de ses positions nous enjoint à ne pas répondre mollement à la droite dure. Cette opportunité d’une reconstruction idéologique de la gauche, le sarkozysme nous l’impose et dans un sens, l’autorise enfin :
« Et c’est sans doute pourquoi, comme au XIXème siècle aussi, ce n’est pas de la victoire de l’hypothèse qu’il est question aujourd’hui, tout le monde le sait bien, mais des conditions de son existence. Et ça, c’était la grande question des révolutionnaires du XIXème siècle : d’abord faire exister l’hypothèse. Eh bien, telle est, dans la période intervallaire qui nous oppresse, notre tâche. » (p. 155) Ne nous y trompons pas : inverser le sens de l’histoire ne sera pas une opération spectaculaire. On ne verra presque rien, et le pouvoir actuel sera sans doute encore en place. Mais quelque chose aura changé que nous aurons préparé par la théorie et la construction critique : au lieu de confisquer le sens de l’histoire, la Restauration ira à contre courant. Elle agira certes toujours avec arrogance, mais la déprime aura changé de camp, et maintenu par un pouvoir à contresens, N. Sarkozy aura perdu la bataille essentielle de son mandat.
Gilles D’Elia
Notes :
[1] Tout le monde le savait, et personne ne peut être excusé d’avoir voté irresponsablement pour lui. Lire à ce sujet le billet publié le 6 mai dernier sur Les Chroniques du Yéti : « Ne nous dites pas que vous ne saviez pas, que vous ne pouviez pas prévoir. C’est faux. Vous aviez toutes les cartes à votre disposition pour juger, l’histoire du karcher, les rafles dans les établissements scolaires, aux restaurants du coeur, les plans sociaux massifs, les entreprises et les services publics pillés par la mafia libérale, l’homosexualité et les dépressions déclarées comme maladies "génétiques"... Pas la moindre excuse. »
[2] Bertrand Vergely, « Cassirer, la politique du juste » (p. 13), Michalon 1998.
[3] Alain Badiou, « De quoi Sarkozy est-il le nom ? » Circonstances, 4 - Editions Lignes.
[4] Sur l’urgence, pour le travail critique, de renouveller le sens du projet démocratique en lui redonnant ses qualités perdues, lire l’essai de Jacques Rancière, « La haine de la démocratie » La Fabrique éditions, 2005.
[5] Cf. Jean-Jacques Rousseau, « Émile ou De l’éducation, livre V » : « À l’instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres, le peuple se divise. Il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l’un, et le tout moins cette partie est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est pas le tout ; tant que ce rapport subsiste il n’y a donc plus de tout, mais deux parties inégales. Au contraire quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même, et s’il se forme un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors l’objet sur lequel on statue est général, et la volonté qui statue est aussi générale. »
[6] Lire à ce sujet l’essai de Pierre Tevanian : « La république du mépris », aux éditions La Découverte, 2007. De nombreux textes de cet auteur traitant la même problématique sont disponibles sur le site Les mots sont importants.
[7] C’est dans ce texte (p. 672 des œuvres complètes de Saint-Just en Folio Histoire) que l’on trouve la formule la plus célèbre de son auteur : « Le bonheur est une idée neuve en Europe. »
[8] Cf. Programme du Conseil National de la Résistance. Ecouter aussi le reportage réalisé sur le programme de CNR réalisé par Giv Anquetil pour l’émission de Daniel Mermet « Là-bas si j’y suis ». Voir enfin la belle vidéo de l’appel à la commémoration du 60ème anniversaire du Programme du Conseil National de la Résistance lu par les figures historiques de la Résistance (Lise London, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Philippe Dechartre, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont, Georges Séguy, Maurice Voutey).
[9] Cf. Droit au logement : « Attribution d’office - Réquisition : une urgence, une loi. La dérobade des pouvoirs publics »
[10] Cf. Discours de Bercy de N. Sarkozy, avril 2007.





Messages
1. La démocratie au pied de la lettre : De quoi Sarkozy est-il le nom ?, 23 novembre 2007, 13:59
j’ai lu le livre, badiou reste quant même très supérieur à beaucoup, il faut le lire ce ptit livrer et lire l’être et l’événement...ou son saint paul, fabuleux.