Accueil > IMMIGRATION... DISCOURS PUBLICS, HUMILIATIONS PRIVÉES
IMMIGRATION... DISCOURS PUBLICS, HUMILIATIONS PRIVÉES
Publie le lundi 24 septembre 2007 par Open-Publishing
Liberté 62 n°775 - Le 21 Septembre 2007 - 2 – Idées
IMMIGRATION... DISCOURS PUBLICS, HUMILIATIONS PRIVÉES
Par Jérôme Skalski
Deux décennies après Le Creuset français, Gérard Noiriel, historien, directeur d’études à l’EHESS, et président du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH) dresse, dans Immigration, antisémitisme et racisme en France, un bilan des recherches historiques menées sur l’immigration en France depuis vingt ans afin d’éclairer, dans le cadre d’une réflexion critique globale, les enjeux attachés aux débats et aux discours portant sur le « problème de l’immigration ». Un livre à lire d’urgence...
L’ORIGINALITÉ de l’ouvrage de Gérard Noiriel tient tout d’abord à sa problématique. Son sous titre, discours publics et humiliations privées, en indique le fil conducteur : faire une analyse historique et sociale du rapport entre les discours publics sur l’immigrant et les humiliations privées vécues par ces immigrants, c’est-à-dire une analyse du rapport entre la production sociale de ces discours et leur réception. Il réside ensuite dans son contenu. Nous esquisserons ici un résumé de ses deux premiers chapitres.
Le problème de l’immigration
Le « problème de l’immigration » fait partie de ces expressions qui semblent aujourd’hui aller de soi. Dès le premier chapitre de son livre, Gérard Noiriel souligne à cet égard un fait essentiel : « Le « problème » de l’immigration a fait irruption dans le débat public français entre 1880 et 1900. C’est seulement à ce moment là que l’opposition entre le national et l’étranger, qui nous semble si naturel aujourd’hui, est entré dans le sens commun ». Le « problème de l’immigration » a une histoire. Il est né sur la base de conditions historiques déterminées et à partir d’une certaine matrice dont nous relevons toujours. Il se constitue tout d’abord au moment où la frontière entre « français » et « étranger » se trace et se fixe historiquement, avec la Troisième République.
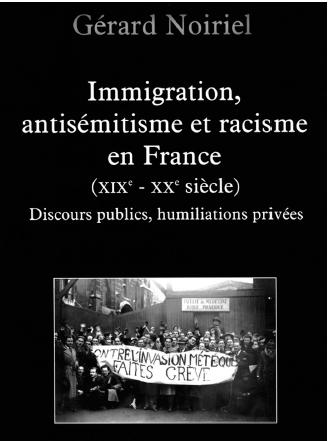
Civiliser le peuple
Pendant toute la période qui va de la Révolution au Second Empire, l’idée de « civiliser le peuple » s’impose dans le débat public. Or, « civiliser le peuple », ce n’est pas seulement, dans l’esprit de ceux qui en font état, la classe des « notables » qui domine l’espace politique dans les deux premiers tiers du XIXème siècle, civiliser les peuples « colonisés » hors des frontières de la métropole mais encore « civiliser » les « masses », le « peuple » par oppositions aux « élites ». Dans ce cadre, la représentation des migrants qui peuvent venir tout aussi bien des régions françaises – la Creuse, la Bretagne...- que de l’extérieur du territoire français – le Piémont, la Belgique...- n’est pas articulée au clivage qui oppose le « national » et l’« étranger » - opposition qui n’existe pas encore - mais au clivage qui oppose « élite » et « peuple » saisi comme « classe laborieuse et dangereuse ». Or, avec la Troisième République, selon Gérard Noiriel, une rupture s’observe. Dès lors, le « eux » et le « nous » n’oppose plus, du point de vue des « élites », le « peuple » et les « élites » mais, dans le cadre d’une reprise du projet républicain, l’« étranger » et le « national ». Ce nouveau clivage qui se met en place - la première loi sur la nationalité française ayant pour objet de tracer une ligne de démarcation juridique claire entre Français et étrangers date de 1889 – s’accompagne d’une redistribution générale de l’espace public. Trois pôles professionnels, dans ce nouvel espace, vont jouer, selon Gérard Noiriel, un rôle déterminant dans la production de la parole publique en général et du discours public sur l’immigration en particulier : le pôle politique, le pôle journalistique et le pôle universitaire.
La mise en place de l’espace public républicain
Premier pôle social de production du discours public sur l’immigration : le pôle journalistique. Le journalisme de masse moderne – la grande presse capitaliste – qui naît en France avec la Troisième République élabore un certain nombre de thèmes attachés à l’immigration en la connectant avec la rubrique du « fait divers » érigée en rubrique de « grande » politique : « l’étranger criminel », « les rixes entre ouvrier Français et étranger »... ou encore de l’actualité internationale : « l’étranger terroriste », « l’espion étranger »... Cette matrice thématique dans et par laquelle le stéréotype de « l’immigré » est mis en scène dans des situations négatives est celle-là même qui, selon Gérard Noiriel, informe les discours publics contemporains. Autour de « l’affaire Dreyfus », l’opposition politique social-humanitaire/national-sécuritaire concernant l’immigration s’articule à l’axe droite/gauche. C’est autour de ce deuxième pôle social de production du discours public que le « problème de l’immigration » se cristalise pour longtemps. Troisième pôle : le pôle universitaire. A partir de la Troisième République on voit naître une catégorie nouvelle qui est celle des « experts », la plupart du temps des « experts » universitaires qui vont utiliser leur savoir pour répondre à des questions qu’ils n’ont pas eux-mêmes posé mais qui ont été posées par le pouvoir politique. Dans ce nouvel espace, par exemple, un nouveau « problème » apparaît : le « problème juif » comme évidence du « sens commun ». Même ceux qui ne sont pas antisémites se disent : « On ne peut pas nier que les juifs posent problème... », « le fait même qu’ils sont victimes de persécution, c’est bien la preuve que ces gens-là posent problème... ». Mis en scène par la presse de masse, pris en charge par le discours politique, expertisé, le « problème juif » était devenu, c’est-à-dire construit et produit comme une « évidence » et comme un « fait » social.
L’histoire ne se répète pas, elle a le hoquet...
Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en
France (XIXe-XXe siècle) : Discours publics, humiliations
privées, Paris, Fayard, 2007.
Gérard Noiriel, historien, directeur d’études à l’EHESS et président du Comité de Vigilance face aux Usages publics de l’Histoire (CVUH) (http://cvuh.free.fr/) a publié de nombreux ouvrages concernant l’histoire de l’immigration parmi lesquels : Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle (Seuil, 1988), Réfugiés et sans papiers. La République et le droit d’asile, XIXXXe siècle (Hachette, collection « Pluriel », 1998), Population, immigration et identité nationale en France (XIXe-XXe siècle) (Hachette, collection "Carré- Histoire", 1992), État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir (Belin, collection « Socio- Histoires », 2001), Atlas de l’immigration en France (Éditions Autrement, 2002), Gens d’ici venus d’ailleurs. La France de l’immigration de 1900 à nos jours (Éditions du Chêne, 2004).




