Accueil > Participation-dénonciation, un acte citoyen ?
Participation-dénonciation, un acte citoyen ?
par Geneviève Koubi
Publie le mercredi 20 juillet 2011 par Geneviève Koubi - Open-Publishing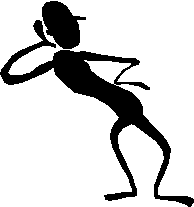
Circ. 22 juin 2011, dispositif de participation citoyenne...
La question de la « sécurité » hante les étés...
Critiqué par le ministre de l’Intérieur, le rapport thématique de la Cour des comptes sur l’organisation et la gestion des forces de sécurité, livré au public par Le Monde (en .fr), interfère dans le débat ; ce rapport qui met au jour « le rôle grandissant des polices municipales » [1], ne s’appesantit pas sur le rôle désormais dévolu aux citoyens, dits "voisins vigilants", par l’intermédiaire de la circulaire du 22 juin 2011 relative au dispositif de participation citoyenne.
Si l’on peut relever que ce rapport « critique vivement la gestion des forces de sécurité » [2], si l’on peut remarquer qu’il souligne les décalages entre les discours et les faits, ces discours constituent néanmoins les principaux « faits » insufflés dans les circuits médiatiques. Certains supports de ces discours — politiques plus qu’administratifs — sont toutefois soigneusement laissés de côté, éteints plus qu’oubliés, alors qu’ils retraduisent les objectifs déterminés par les pouvoirs publics en matière de sécurité publique et de maintien de l’ordre.
Aussi, sans s’attarder sur le ‛changement de style linguistique’ que le jeu de chaises ministérielles a impulsé en la matière, la circulaire du ministre de l’intérieur du 22 juin 2011 relative au dispositif de participation citoyenne doit-elle être appréhendée dans ce contexte spécifique qui associe la problématique de la « participation » des citoyens à divers opérations ou processus [3] et la rhétorique « sécuritaire ».
La circulaire du 22 juin 2011 commande le développement des « actions partenariales » dans le but de faire entrer la « population » dans les mécanismes des politiques de sécurité — et sans doute ainsi pallier aux dysfonctionnements d’un service public atteint par la réduction des effectifs [4]. En matière de sécurité et de lutte contre la délinquance, la participation sollicitée revêt un caractère spécifique qui confine à l’appel à la délation, à la culture de la dénonciation — plutôt qu’à celle du témoignage…
La circulaire du 22 juin 2011 insiste sur le fait que l’effort de « participation citoyenne » doit porter sur les quartiers, lotissements ou zones « régulièrement touchés par des phénomènes de délinquance multiformes » ; une dérivation permet aux acteurs de la sécurité publique de s’intéresser à des « secteurs plus ruraux » sans que la dynamique de cette participation recherchée des populations concernées soit détaillée. L’objectif exposé est certes de freiner l’extension de la délinquance, mais il est aussi et surtout de distribuer quelques cachets ou pilules destinées à porter remède à une confiance en les institutions publiques qui décline progressivement dans ces espaces où la présence d’une police est vécue comme harcelante et suscite réticence, voire hostilité. Il s’agit donc de revenir à la rhétorique du « sentiment d’insécurité » afin d’impliquer tous et chacun dans une amélioration calibrée du "vivre ensemble".
De fait, cette circulaire signe l’échec des politiques de sécurité menées depuis quelques années ; elle est un des indices des revers de la « guerre » engagée contre les délinquants par les pouvoirs publics [5]. En quelque sorte, après en avoir appelé à une implication plus intensive de la part des collectivités territoriales [6], le ministre de l’intérieur se trouve ici contraint de se référer à la population…
Le dispositif envisagé n’est pas encore généralisé — et s’il devait l’être, resterait enserré dans des critères spécifiés géographiques, démographiques et sociologiques. Il est loin de répondre à ces esquisses prédéterminées… par une tentative d’importation d’un outil de facture anglo-saxon qui n’inscrit ni la conception collective du voisinage, ni la culture administrative de la proximité, ni la composition juridique de la société française. La circulaire donne, en effet, une définition de ce dispositif de participation citoyenne marquée par des méthodes dépassées ; il « s’inspire du concept de “neighbourhood watch” mis en œuvre depuis de nombreuses années aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (…). Il s’agit de l’engagement des habitants d’une même aire géographique (quartier, lotissement, résidence, village, ….) dans une démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité du secteur ». Est-ce signifier qu’en chacun sommeille un surveillant, un policier, un justicier ... qu’il s’agirait ainsi de réveiller ?
Les différents instruments mis en application auparavant, des contrats locaux de sécurité aux brigades de quartier ou unités territoriales de quartier (UTEQ), paraissent plus que jamais décalés. Les tergiversations quant à la nécessité d’une implantation locale des agents affectés à la "sécurisation" des quartiers, cités, zones, locaux ont considérablement transformé le rapport des habitants de ces lieux aux services de police. L’arsenal pénal qui a accompagné ces remaniements incessants, allant de la délictualisation du stationnement dans les halls d’immeubles à la géolocalisation de l’absentéisme scolaire, a tout autant modifié l’attitude des habitants à l’égard de ces services. La ’peur du gendarme’ n’est en rien instructive ni pédagogique !
Toutefois, la circulaire use d’un ton mesuré pour ce qui est de l’intervention attendue de la population de ces quartiers et zones dans le circuit d’une vie sociale policée. Pourtant, la stratégie de communication est d’ores et déjà offensive et discriminante. Les enjeux affichés sont de créer une « solidarité de voisinage » fondée sur une conception de la « normalité » configurée par les pouvoirs publics. S’ensuivra alors, inévitablement, la désignation des trublions, des insolents et des frimeurs, des marginaux ou des exclus, des "autres"… Certes, le ministre évoque dans cette circulaire la recherche de l’engagement de la population « par des actions de sensibilisation… », par l’organisation de réunions durant lesquelles les acteurs habilités devront « expliquer les modalités et les apports du dispositif »… Ces opérations de sensibilisation prennent les couleurs d’une propagande entonnant le refrain de la lutte contre toutes les formes de délinquance, sans tenir compte de l’âge des délinquants présumés. Elles se justifient jusqu’à ce que des personnes se déclarent « volontaires » pour adhérer aux fonctions proposées et entrer bénévolement mais de plain pied dans le dispositif !
Ces personnes volontaires seront les « citoyens vigilants » qui, en voisins, joueront les rôle de gardiens d’immeuble [7], de veilleur [8], d’agent de sécurité, etc. Mais aussi, elles seront amenées à signaler les comportements « suspects » [9], les faits « anomaux » [10], les hiatus dans l’ordinaire qui assure de la norme !!
Dans les quartiers et zones de densité démographique, est-il possible d’adopter la posture des voisins vigilants qui, en guise de passe-temps, s’ingénient à connaître les soubresauts silencieux des villages ou des quartiers préservés ? Est-ce une attitude respectueuse des libertés de chacun et de sa vie privée que de guetter l’imprévu et de s’inquiéter de ce qui se déroule chez autrui ? Est-ce faire preuve d’un comportement de ‘bon voisinage’ que d’épier les passages, de relever les allées et venues, de noter chaque petit fait sortant de la routine ordinaire ? C’est pourtant sur la « capacité de détection des situations anormales », selon les termes mêmes de la circulaire, que repose la stratégie sécuritaire imaginée par le ministère de l’intérieur afin de faire d’un citoyen un supplétif des forces de police, nationale ou municipale. C’est grâce aux observations délivrées par un citoyen dit ’volontaire’ [11] pour occuper cette fonction de ’voisin vigilant’ que les forces de sécurité pourront « cibler » leurs interventions…
Collaborateur occasionnel du service public, le voisin vigilant ? Il ne pourrait l’être que par inadvertance ou bien, sans préjuger des analyses encore à venir, le cas échéant. Mais est-ce utile alors de préciser qu’en tout état de cause il ne saurait « se prévaloir de prérogatives administratives ou judiciaires » [12] ?
.
Sans commentaire !
.
[13]
Notes :
[1] p. 107 et suiv.
[2] … comme l’indique un article publié dans Le Monde du 8 juillet 2011.
[3] D’ailleurs, tel est le thème du rapport public de 2011 du Conseil d’Etat sur la participation des citoyens à la prise de décision publique.
[4] Cette méthode est désormais appliquée en tous domaines, chacun étant devenu, malgré lui, un agent administratif. Les exemples sont nombreux ; sans s’arrêter sur les téléprocédures qui illustrent couramment ce type de situations, peut être donnée en exemple la disparition des ‘poinçonneurs’ à l’entrée des quais dans les stations et gares, ce qui correspond en fait à un transfert des tâches de contrôle sur l’usager. Composant lui-même les dossiers qui lui sont nécessaires, remplissant seul les formulaires indispensables, l’honneur de chaque administré est engagé sous peine de… tandis que l’agent public qui devait assurer autrefois la vérification correspondante est désormais affecté à d’autres besognes…
[5] Échec et revers se voient alors confirmés par les analyses opérées par la Cour des comptes en son rapport rendu le 7 juillet 2011.
[6] V. par ex. la circulaire du 17 juillet 2002 relative aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance qui invitait à « - accentuer la logique d’implication des élus dans l’élaboration des priorités de l’action collective pour une meilleure sécurité et dans l’organisation des stratégies des multiples acteurs concernés ; - dans le même esprit, assurer et améliorer l’information spontanée et régulière des maires par les services de l’Etat sur les actes de délinquance commis dans leurs communes et sur les actions mises en œuvre ; - simplifier le nombre et la nature des structures de concertation et de coordination qui existent aujourd’hui pour traiter de la prévention de la délinquance, de l’élaboration et du suivi des contrats locaux de sécurité, de l’échange d’informations et de la coordination des différents intervenants »…
[7] Et effectueront le « ramassage du courrier des vacanciers » !
[8] De la « surveillance des logements inhabités »…
[9] L’exemple donné dans la circulaire des « démarcheurs trop insistants… » laisse perplexe.
[10] D’où la précision d’une observation des « véhicules semblant en repérage »…
[11] Et sans aucun doute à ’ficher’ un jour...
[12] Le dernier paragraphe de la circulaire fait ‘tilt’ chez les juristes : « Des travaux juridiques sont en cours pour consolider ce dispositif. »… Cette phrase est imprimée en caractères gras. Faut-il y voir une incitation à accéder au statut de veilleur ou d’espion... voire de ’balance’...
[13] NB : voir également l’article publié sur Rue89 à ce propos :




