Accueil > Hier, je suis mort, N°1
Après, Le Con existe, je l’ai rencontré !, l’Ancêtre, je continu la série avec : Hier, je suis mort. Comme on le verra, j’ai un peu égratigné nos compagnes, mais c’est avec tendresse et sans aucuns machisme volontaire ou inconscient de ma part, simplement par fantaisie d’auteur.
Michel MENGNEAU
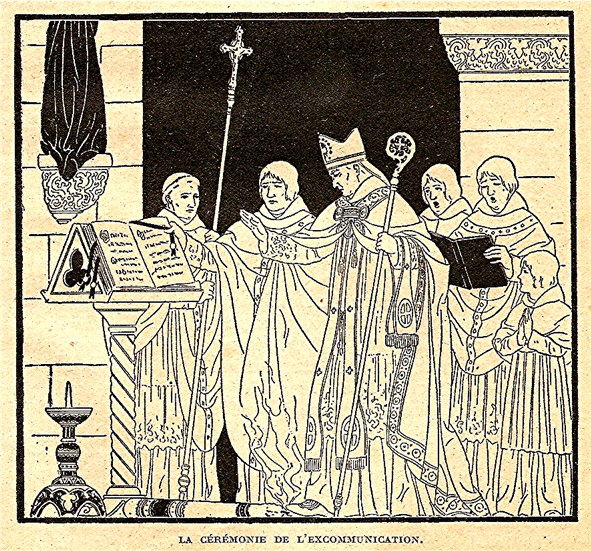
L’acte le plus important de notre vie,
c’est notre mort.
Ernest RENAN
Hier, je suis mort,
Je n’ai jamais eu envie, à l’approche de l’échéance fatale, de plagier Châteaubriant en racontant les petites péripéties de ma vie. D’autant que la lecture des Mémoires d’Outre-Tombe, à laquelle on ne peut échapper dans sa jeunesse, m’a profondément ennuyé. Si j’ai écrit : ennuyé, c’était pour rester poli. Puisqu’un terme un peu moins respectueux aurait mieux décrit mon état d’âme pendant les longues heures où j’ai planché sur les quarante-quatre Livres de ce Monsieur.
Mais, hier, je mourus. Et, cette fois, j’ai bien l’intention de relater les avatars de ma mort, et la suite.
Je repose. Du moins, je me repose. Peinard. Pour une fois que je peux faire une petite sieste sans qu’un opportun vienne la troubler, quel bonheur !
Donc, les deux mains croisées sur la poitrine, j’écoute les funestes paroles de mon entourage.
Générique :
La nuit dernière, en plein sommeil, la grande faucheuse est venue me chercher. Elle ne savait pas quoi foutre, probablement. Car après son surcroît de travail à la suite de la canicule, elle s’est retrouvée avec un petit trou dans son emploi du temps.
En effet, beaucoup de petits vieux ayant été liquidés d’un seul coup, sous prétexte qu’ils auraient fait un peu désordre à travers les jeunes dans les piscines où ils auraient pu se rafraîchir, elle a donc failli se retrouver au chômage en raison du manque de clientèle nouvelle. Mais, ne pouvant pas rester inactive, elle a fini par trouver d’autres clients. Malheureusement j’étais du lot.
Tout d’abord, nous n’étions pas d’accord. Moi, je n’avais pas envie. Elle, elle était pressée. Devant les femmes, j’ai toujours eu quelques faiblesses. J’ai finalement cédé.
Toutefois, comme je n’aime pas que l’on m’emmène n’importe où et n’importe comment, j’ai posé des conditions – on peut toujours essayer, n’est-ce pas ? Pour des raisons personnelles, je lui ai demandé de jouir un peu de ma mort. Puis d’écrire un post-scriptum. Pourquoi pas ? Ce n’est pas tous les jours qu’arrive ce genre d’événement.
Vous auriez vu sa tête, elle était verte. Apparemment, il ne lui était pas arrivée souvent qu’on lui pose ce genre de question.
Alors, afin de couper court à des récriminations encore plus longues de ma part, en utilisant l’une des spécialités de son sexe elle s’écria le regard faux : « pressez-vous, Monsieur, le temps nous attend ! ».
Non, Madame, nous avons l’éternité !
Faut tout de même pas se laisser diriger constamment par les gonzesses !
On dit cela, orgueilleux et fier. Mais, quant on a prévu une partie de pêche avec les copains ou de regarder à la télé le XV de France se faire étriller par les Alls-Blacks, et que, elles, ont décidé qu’il était urgent de déboucher le siphon de l’évier ou de nettoyer le filtre du lave-linge, on obtempère. C’est inéluctable, allez savoir pourquoi, elles ont toujours le dernier mot.
La preuve : je suis mort.
Fin du générique.
La réalité est beaucoup plus prosaïque. Sans le baratin imaginaire de la dame en noir et du dialogue, tout aussi imaginé – hum, il y a peut-être à travers quelques pointes de réalité – relaté ci-dessus…, je suis mort à mon insu. Le plus simplement du monde, au milieu de la nuit j’ai continué à dormir d’un sommeil différent. Seule une petite note le différenciait du précédant ; c’était mon ronflement : il avait cessé ! Ma compagne ne s’en est d’ailleurs pas aperçue. Ses ronflements ne la réveillant pas, il n’y avait aucune raison pour que la cessation des miens la perturbe.
Par contre, son éveil fut assez étonnant.
L’occasion rêvée, car, après des années de récrimi-nations de ma part à l’encontre de ses habitudes, elle se levait avant moi. Elle pouvait donc me houspiller à son aise, me traiter de fainéant, de dort tard, sans que je puisse, pris sur le fait, trouver quelque chose à redire. Ce qui était, de toute façon, un paradoxe lorsque l’on connaît les journalières longueurs de ses grasses matinées ! Bref, en enfilant illico, la mine réjouie, mon pantalon de velours afin de bien me faire comprendre : qui, à la maison, portait dorénavant la culotte, elle me secouait comme un prunier. Seulement, dans ma nouvelle condition, même secoué comme un vieux tronc sur lequel il reste encore quelques fruits, il était impossible de me réveiller. Le doute s’instaura alors dans son esprit. Et, à la suite de divers examens successifs, elle se résolue à conclure que ma léthargie n’était pas momentanée, mais définitive.
Pourtant n’ayons pas peur des mots, j’étais, sans contestation – elle a même tenté en ultime espoir le bouche à bouche – on ne peut plus : mort.
De fait, elle se mit à hurler, geindre, puis pleurer. J’en étais sincèrement désolé. J’aurais tant aimé la consoler de sa nouvelle condition de veuve. Mais devant mon incapacité bien involontaire à apporter un peu de réconfort à son état d’âme, je la laissais seule avec son désespoir.
Malgré tout, la vie ordonnée reprend toujours son cours. Et, sous peine d’être classée au rang des assassines, son requiem lacrymal orchestré de lamentations exhaustives un peu apaisé, elle s’est souvenue qu’il lui fallait impérativement prévenir les autorités. Ce dont, pour ma part, je me serais bien passé !
Le téléphone dans une main, le mouchoir dans l’autre pour éponger des sanglots rémittents, elle réussit enfin à joindre le portable de l’un de mes amis médecin, malgré plusieurs tentatives infructueuses.
Soit dit en passant, ces machins modernes, tant vantés, ont souvent des problèmes de réception lorsqu’ils sont dans des endroits non couverts par leurs opérateurs.
La communication établie, elle tenta de lui expliquer d’une voie hachée qu’il était urgent de venir constater mon état. Sans oublier de préciser, avec un brin de rancœur dans la voix, que je la laissais seule accomplir toutes les démarches obligatoires et officielles en cette circonstance : moralité, j’étais devenu égoïste.
Elle a même pensé, je l’ai lu dans son œil de droite absent de toute larme : « depuis le temps qu’il me casse les pieds à vouloir regarder à l’heure du thé les Chiffres et les Lettres à la télé, il aurait mieux fait de suivre les conseils donnés par la pub de l’assurance british qui précède cette émission ». Celle où un ancien copain de G. Brassens, déguisé en pêcheur pour gagner sa vie, vous explique qu’il faut assurer les housses de protection des fauteuils du salon, dans le cas où les enfants qui vont hériter ne pourraient pas vendre ceux-ci, souillés par les incontinences des vieux. Sinon, à cause de cette imprévoyance manifeste, ils n’auront pas suffisamment de sous pour payer l’enterrement. Si elle a pensé qu’il aurait été judicieux de prévoir ces choses-là, elle n’a jamais osé le dire ouvertement de mon vivant, sachant que j’aurais gueulé à l’escroquerie de la part de ces assureurs, de surcroît : anglais !
Sur ces entrefaites, le toubib arriva. Dans le vestibule de ma demeure, en se débarrassant de son manteau sur la patère de la porte d’entrée, il bougonna tout seul des propos prémonitoires à mon encontre ; mais avec une certaine hypocrisie, car suffisamment fort de manière que je puisse l’entendre dire : « j’espère qu’il va y passer ! A force de faire le con, ça lui pend au nez ! ».
Au téléphone, à travers les pleurs de ma compagne, il n’avait pas compris que le pire était dèjà arrivé. Mais sur le pas de la porte de ma chambre il s’arrêta stupéfait, et dit d’une voix dépitée : « Merde ! C’est fait ! ».
De loin, son œil de professionnel exercé depuis un bon nombre d’années à ce genre de situation avait tout de suite déterminé l’irréversibilité de mon état. Alors, de près, il maugréa des insanités à mon égard. Entre autres, comme quoi il était amoral de mourir sans la présence d’un digne successeur d’Hippocrate. Mais surtout, vexé, parce qu’il fut obligé de conclure à une mort naturelle due à l’usure du temps ; et a fortiori nullement provoquée par un abus inconsidéré des bonnes choses de la vie. J’ai d’ailleurs entrevu dans son regard scrutateur quelques regrets.
A l’évidence, il aurait préféré ne pas être contraint à reconsidérer son pronostic premier, et d’y aller d’une belle engueulade posthume !
C’eut été un comble ! Car, si je me souviens bien de sa jeunesse, à l’époque où il était carabin, combien de fois ses copains m’ont demandé de venir le chercher. Ce Monsieur ne pouvant plus se mouvoir, du fait des conséquences éthyliques d’une nouba monstre qu’il avait organisée à l’internat de l’hôpital. Ou, pire encore, à peu près dopé par le même genre de médicaments ingurgités dans le cas précédent, parce qu’il courait surexcité dans les couloirs de l’Ecole d’infirmières en voulant sur le champs ausculter l’une de ces demoiselles, et surtout lui montrer le bon fonctionnement de son... stéthoscope.
Ce qui prouve que lorsque ce genre d’individu prend du galon dans l’échelle sociale et devient une sommité reconnue, un notable établi ou un bourgeois parvenu, il est atteint d’une amnésie de bon aloi sur les inconvenances de ses frasques passées.
Si je pouvais me lever, je lui botterais volontiers les fesses ! Ca permettrait peut-être à ses souvenirs de se remettre en place.
Ainsi furent accomplies les formalités qui me donnaient l’autorisation de rejoindre, dans l’au-delà, certains de mes amis attirés par la quête du Bonheur dans ce « Jardin » philosophique cher aux disciples d’Epicure.
Une fois toutes les diverses tracasseries administratives enfin réglées, une nouvelle et lourde tâche attendait ma femme : m’habiller. C’était en effet un problème auquel elle n’avait pas encore été confrontée. Elle avait toujours préféré me déshabiller dans la position verticale, plutôt que de tenter de m’habiller : couché ; ce qui à son avis, dans le premier cas, émoustillait sa libido, et ne comportait aucun intérêt dans le second.
Tout nu sur mon lit, je vis dans son regard un peu de perplexité. Effectivement, un grand cadavre comme le mien n’est certes pas quelque chose de facile à vêtir et manipuler. A la suite de cogitations intimes, elle décida, en dernier recours, de faire appel à la voisine.
Celle-ci vint alors en traînant la savate ; un peu mal à l’aise, sembla-t-il, d’être embauchée pour un tel rituel. Mais, vous savez, même si cela ne réjouit pas forcément, dans la peine, il faut passer outre à ses réticences et aider son prochain !
Dès son arrivée dans ma chambre, le visage de la dame changea. De morne qu’il était, il devint légèrement concupiscent. Alors, ne pouvant pas cacher l’endroit où ses yeux s’attardaient longuement, j’eus peur. Pourvu ! Mais pourvu, qu’elle ne soit pas comme ces femmes fétichistes qui ne peuvent garder près d’elles leurs attributs préférés ! Et qui, afin de couper court aux fantasmes extraconjugaux de ceux-ci, les transforment en reliques bringuebalantes, pendues à une chaîne portée en sautoir.
De préférence, Madame, il serait de bon ton que l’on me conservât entier !
Cette réticence ne vient aucunement du fait que je ne veuille pas faire don de mes organes à la science, bien au contraire. Surtout s’ils peuvent contribuer à sauver des vies humaines. Mais, si j’ai émis quelques réserves, c’est qu’il y a certaines parties sensibles de mon anatomie dont je n’aimerais pas qu’elles tombassent entre n’importe quelles mains, qui à l’occasion les manipuleraient de façon malhabile. Aussi, après les avoir longtemps partagées avec ma compagne, demandez lui donc si dans sa bouche le terme « exclusivité » n’est pas un leitmotiv ! Comme je n’ai aucune prédilection pour les conflits, en restant pourvu je pourrai peut-être ainsi éviter quelques crêpages de chignon.
Elles durent m’entendre regimber. Aussitôt elles allèrent quérir un quelconque pantalon dans la penderie et me l’enfilèrent prestement, sans doute pour cacher au plus vite l’objet de maints regrets. Dans la foulée, elles firent de même avec mes chaussettes et ma chemise. A contrario de leurs désirs profonds, je commençais à devenir plus décent. Puis de nouveau, il y eut un flottement, une interrogation : Faut-il lui mettre une cravate ?
La question de la cravate se posait en effet.
Qu’allaient-elles décider ?
Car elles avaient auparavant commis une bévue vestimentaire qui avait déjà commencée à me chagriner.
J’aurais bien aimé les interroger : pourquoi ce pantalon des plus standards m’avait-il échu ? Pourquoi m’affubler de ce triste futal classique qui ne me servait que dans des circonstances très particulières ? Porté, par exemple, lors d’un rendez-vous obligé, dont je me serais fichtrement bien passé, où je dus affronter un contrôleur d’impôt pointilleux ; moralité, tenue de rigueur obligatoire en cette triste occasion pour paraître un citoyen honorable bien calé dans le rang.
Où est donc mon vieux pantalon de velours, gardien de tant de souvenirs ? Pourtant il a toujours été un compagnon fidèle. Il eût été normal qu’il m’accompagnât dans cette aventure. Ah, oui, c’est vrai ! J’oubliais. Ma femme me l’avait taxé à son réveil. L’avait-elle gardé par défit ? Ou peut-être avait-elle oublié qu’elle le portait, tant il est confortable ? Ou plus probablement, ces dames l’ont écarté en pensant qu’il ferait désordre en ce cérémonial.
Raisonnement trop conventionnel, à mon goût. C’est parfois rageant d’être réduit au silence ! Car elles m’auraient entendu crier haut et fort : « Au diable, les conventions ! ».
Fut-ce le fait d’avoir invoqué le diable, en tous cas à propos de la cravate elles s’interrogeaient. Normalement la question ne se pose pas, la pompe établie le conseille fortement. Néanmoins, ma compagne, qui me connaît bien, savait que ce bout de tissu pendouillant ne m’avait jamais séduit. Même qu’il était souvent la représentation de certaines formes sociétales qui m’exaspéraient de mon vivant. Alors, elles eurent une idée de génie : un nœud papillon !
Enfin un instant d’originalité. De plus, mon âme bucolique si accordait parfaitement. Me faire chatouiller le menton par un gros papillon aux couleurs chatoyantes, un vrai petit moment de bonheur. Voilà, attendue depuis un moment, une pointe d’anticonformisme comme je les apprécie ! Mes grincements de dents s’étaient calmés d’un coup.
Malheureusement on ne peut pas effacer en un instant des habitudes depuis trop longtemps ancrées dans les esprits. Elles se réinstallèrent donc dans le conformisme en m’affublant d’un petit nœud grisâtre. Puis dans la continuité elles m’endossèrent, non sans mal, une veste banale ; celle surnommée la veste du dimanche. Cela m’a fait bizarre, moi qui porte rarement une veste, et encore moins le dimanche. Enfin, pour parachever leur ouvrage, des chaussettes noires et une paire de chaussures vernies vinrent orner mes pieds.
Drôle d’idée, car, là où j’allais, ces godasses étaient tout à fait superflues puisque j’y serais aimablement porté en grandes pompes.
Bien installé au milieu de mon lit, déguisé en pingouin à l’instar d’un quidam qui va à une réunion du Rothari Club, l’air apparemment serein – à l’intérieur il en était tout autrement, ça commençait sérieusement à bouillir ! –je pouvais attendre l’avenir…




