Accueil > L’étrange victoire des idées de droite
L’étrange victoire des idées de droite
Publie le mardi 24 juillet 2007 par Open-Publishing9 commentaires
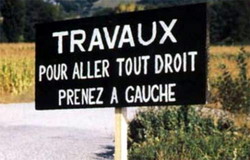
Le Parti socialiste et la gauche en général ont perdu, ce printemps 2007, la bataille tactique des idées, des mots et des représentations de la question sociale. Immigration, insécurité, délinquance ainsi que les "valeurs" : "identité nationale", "autorité", "travail", "morale", "nation", sont désormais les mots clés du débat politique.
L’idéologie de gauche a été reléguée dans une position où elle est apparue comme consensuelle et péremptoire. Ses "bons sentiments" manichéens, sa propension à déresponsabiliser l’individu et à favoriser "la repentance" collective, ont été dénoncés comme une source de crise et d’immobilisme.
Durant la campagne présidentielle, les partisans de la "justice sociale", du PS jusqu’à la gauche radicale, furent rejetés comme des combattants d’arrière-garde, bien moins "révolutionnaires"/neufs dans leurs idées que d’autres candidats pourtant membres de partis conservateurs (Nicolas Sarkozy, François Bayrou).
Comment expliquer, avec quelques semaines de recul, cette nette victoire de l’idéologie de droite ?
– « Le pouvoir se gagne par les idées » … Retour sur une victoire politique annoncée.
Journaliste : « À quatre jours du premier tour, on a le sentiment qu’aucun thème n’a structuré la campagne… » N. Sarkozy : « Je ne suis pas d’accord. Le vrai sujet de cette présidentielle, ce sont les valeurs. Par le passé, il est arrivé, c’est vrai, qu’un thème unique s’impose à tous les autres. En 1997, les 35 heures et les emplois jeunes. En 2002, la sécurité. Cette année, derrière les apparences d’un certain zapping, tout – le travail, l’éducation, l’immigration, la sécurité – s’ordonne autour de la crise d’identité que traverse la France. D’où ma campagne sur le sens et sur les valeurs, qui désoriente certains commentateurs mais dont les Français ont bien compris la nouveauté : je ne mène pas un combat politique mais un combat idéologique. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à faire une synthèse de mes convictions dans mon dernier livre, Ensemble. Au fond, j’ai fait mienne l’analyse de Gramsci [1] : le pouvoir se gagne par les idées. C’est la première fois qu’un homme de droite assume cette bataille-là. » Sources : interview de N. Sarkozy pour Le Figaro, 17 avril 2007.
Pourquoi la vision du monde du candidat de l’UMP s’est-elle majoritairement imposée dans les esprits ? A tout le moins, parce qu’elle a fait l’objet d’une tactique idéologique délibérée voire libérée (« coming out de la droite »). Cette tactique a résidé dans l’invention d’un discours de « rupture ». Un « nouveau » discours qui a ouvert un espace de représentations de la question sociale : « la crise de l’identité nationale » et l’a imposé comme une analyse réaliste de la réalité. Les allocutions de campagne de M. Sarkozy sont presque exclusivement fondées sur le développement et la description d’une vision du monde explicite et d’un diagnostic s’y référant. Le schéma suivant tente de résumer cette offre de société :
Premièrement, la déconstruction de la théorie de gauche et de son « laisser faire »/ « relativisme » normatif dans tous les domaines. Dans le champ économique et social : défense des « assistés » au détriment des « travailleurs », gestion dépensière du service public, immobilisme dont découle le « on a tout essayé » et la volonté de préserver l’« ancien système ». Dans le champ moral et politique : immigration non contrôlée, défense et déresponsabilisation des « voyous », dégradation du « civisme » dans les banlieues, perte de l’autorité. Cette analyse se matérialise, entre les deux tours des présidentielles, dans la critique symboliquement contre-révolutionnaire de mai 68. L’idéologie de gauche, héritée de « 68 », est présentée comme destructrice des « valeurs » et des « normes » voire de « la loi ». Elle aurait mené à la permissivité, au laisser faire moral donc à la remise en question de l’autorité, de la responsabilité individuelle et, par voie de conséquence, aux « incivilités », à la « violence des jeunes », à la « haine » de « soi » et de la « Nation ». Cette critique de la théorie de gauche agit tel un pôle d’unification et de renforcement de la base sociologique classique de la droite (des extrêmes jusqu’au centre).
Deuxièmement, une approche paradoxale de la question économique fondée sur le double ressort d’assumer une politique économique « libérale libérée » d’un côté, une politique économique de protection/contrôle d’un autre. Cette deuxième approche renforce le pôle électoral d’obédience libérale, en général, et comporte une ouverture sur l’électorat social démocrate, sensible à l’application d’un libéralisme à la fois plus franc et plus policé. Entre les deux tours, le discours économique du candidat fait souvent la critique de la « pensée unique ». Le concept créé par la gauche altermondialiste, dans les années quatre-vingt-dix, est ici retourné contre elle. L’objectif est de liquider la notion d’ « antilibéralisme » de la gauche de la gauche. Il faut par exemple défendre l’industrie française et ses emplois (notion de « politique industrielle » comprise comme lutte contre la conséquence des délocalisations : la « désindustrialisation »).
Le but est d’en finir avec une série d’hypocrisies et de culpabilisations injustes. S’il existe des « profiteurs/fraudeurs », cela implique qu’il y ait de vrais « méritants », les premiers étant à la source du problème, les seconds dans la solution. C’est là, la vraie défense des « travailleurs », pas celle que pratique la gauche dont « l’égalitarisme » conduit à avoir moins pour financer l’« assistanat ». Il y a donc deux sortes de citoyens : les bons et les mauvais. De la même manière, qu’il existe de bons et de mauvais « immigrés » : d’une part ceux qui veulent s’intégrer (les « méritants »/« travailleurs »), d’autre part, « ceux qui ne veulent pas respecter nos valeurs » et « ne sont pas les bienvenus dans notre pays ». Ce discours a su montrer à quel point il a momentanément convaincu une bonne part des fameux déçus du « tous pareil » et des auteurs du « vote contestataire » pour le Front National.
Entre la vision « bien pensante » et auto-autorisée à bien penser des « idéologues » de gauche et « la pensée unique » qui aurait pour conséquence « la désindustrialisation »/délocalisation, le candidat parvenait à dégager, dans les mentalités, un espace des possibles pour le moins paradoxal. Il s’agit d’être, lorsque la situation l’exige, « socialement de gauche, économiquement de droite et nationalement de France ». Assertion transformée ici en volontarisme tautologique : parler de « libéralisme sans être libéral, de protectionnisme sans être protectionniste, de nationalisme sans être nationaliste, d’immigration sans être raciste ». Un pragmatisme fondé sur la volonté de « faire bouger les choses », d’« aller dans le bon sens », de ne pas justement être idéologue, irréaliste et donc irresponsable. En disant cela, le candidat de l’UMP invite également les classes populaires de gauche à passer à droite ou plutôt dans « la nouveauté » qui, ne s’encombrant pas des arsenaux théoriques de droite ou de gauche, se recentre sur ce qu’il faut bien admettre comme étant le bon sens, « les valeurs »/vraies.
Par conséquent, l’opération a consisté à faire passer ses thèmes et propres formulations dans les représentations collectives de la réalité. Elle s’est appuyée sur une certaine disposition des mentalités, fruit d’une longue construction sociale et médiatique : pessimisme social, idée de déclin, vulgate libérale comprise comme « réalité/réalisme économique », « problème des banlieues » et de « l’immigration ». Elle puise son inspiration dans le modèle récent de l’imposition hégémonique du thème « insécurité/sécurité ». Le résultat est là : des idées de droite pure, jusque-là politiquement difficiles à assumer, ont formé le discours le plus audible de la campagne.
– Vers une révolution culturelle de droite ?
Les principes fondamentaux des théories libérales et « nationales » ont aujourd’hui fini par gagner les esprits du plus grand nombre. En matière économique : pas de réduction des inégalités sans croissance économique, pas de baisse du chômage sans baisse du coût du travail, pas de baisse du coût du travail sans réduction de l’Etat protecteur. Il faut « débrancher la couveuse », « moderniser » la France. En matière sociale : pas de réduction des problèmes sociaux sans s’attaquer conjointement à la question de l’immigration, de l’insécurité et de l’identité nationale. Il faut « taper fort », restaurer l’autorité, l’ordre moral. Ce terreau idéologique de l’inconscient collectif a permis au nouveau président de se poser classiquement et de manière en apparence légitime, comme l’homme providentiel, le « sauveur » ou « redresseur » du pays.
L’enjeu principal du « combat idéologique » a résidé dans l’objectif de faire passer l’idéologie dominante pour une idéologie dominée et l’idéologie dominée pour une idéologie dominante. La « majorité silencieuse » face au « politiquement correct » de gauche ? Au « mini mai soixante-huit » des jeunes « anti-cpe » du printemps 2006, répond, une nette victoire, par les urnes, du peuple de droite, au printemps 2007. A travers l’attaque contre mai 68, c’est la vision du monde de la gauche que l’on cherchait à atteindre. Il n’est pas du tout certain que nous entendions reparler abondamment de ce thème dans les années à venir. Par contre, ce qui reste de cet épisode du débat de campagne, c’est la tentative réussie de déstabiliser et disqualifier la gauche jusque dans ses racines théoriques et sociologiques les plus profondes. Le combat culturel, sur le même modèle que le combat politique, s’édifie par des idées et des représentations antagonistes, des tactiques conceptuelles, des coups idéologiques et des mises à mort théoriques. La question technique devient alors : comment obtenir le leadership culturel ?
L’utilisation en ce sens du philosophe Antonio Gramsci [1] par la droite n’est pas une nouveauté et puise son inspiration dans la nouvelle droite des années soixante-dix, active aujourd’hui depuis plus de trente ans. Cette génération idéologique est chronologiquement liée à la génération politique qu’incarne Nicolas Sarkozy. Elle est issue de la réaction contre le mouvement de soixante-huit, lui-même issu d’une certaine hégémonie culturelle du marxisme chez les intellectuels des années soixante. Autrement dit, il s’agit initialement d’une réaction historique de la droite contre une certaine influence culturelle de la gauche, magistère exercé par le bais des « intellectuels de gauche ». En ces temps là, sur le terrain du combat intellectuel, la civilisation de droite était malmenée jusque dans ses fondements les plus vitaux. Il fallait réagir, justement, sur ce terrain, en utilisant les mêmes armes mais cette fois-ci au service de la pensée de droite. Une lutte idéologique et culturelle pour la métamorphose des représentations collectives, autrement nommée « métapolitique », politique « au-delà » de la politique, est alors initiée par ce courant de pensée, c’est une lutte à long terme, incertaine mais incontournable.
Face à un candidat qui, tactiquement, dégageait une vision du monde nette, lisible et sûre d’elle-même ; la gauche n’était plus audible. Alors que le parti socialiste et sa candidate restait presque exclusivement au niveau infrapolitique (navigation idéologique « à vue » de sondages, recours au pathos sacerdotal et à la psychologie) ; la campagne de N. Sarkozy jouait sur plusieurs plans et se situait donc, en outre, à un niveau métapolitique. La gauche radicale n’a pas perçu et anticipé les risques de disqualifications et de marginalisation de son discours (un « coming in » de la gauche de la gauche est-il nécessaire ?). Le parti socialiste n’est pas parvenu à dégager une vision du monde claire. Il ne semblait proposer autre chose que des « mesurettes » et une évolution sans doute à l’arrivée perçue comme en elle-même insuffisante : le fait de présenter une femme. Plutôt que de courir derrière les idées du camp opposé, il aurait mieux valu créer un espace à soi pour y entraîner l’adversaire à ses risques et non l’inverse.
Les « pièges idéologiques » ou « métapolitiques » tendus à la gauche par les différents courants politiques de la droite, depuis presque trente ans, se sont révélés efficaces. L’« offensive néolibérale » est parvenue à imposer la pensée économique unique. L’extrême droite a fini par ordonner, ensembles, les thèmes de l’« immigration » et de l’« insécurité » et ainsi faire émerger une conception raciale de l’« identité nationale ». Le « retour » des « classes dangereuses » fut consacré par le nouveau président lui-même, durant son action au ministère de l’intérieur depuis 2002.
La défaite actuelle de la gauche est plus grave qu’il n’y parait. Le Parti socialiste risque de s’orienter davantage encore sur sa droite. L’influence de la gauche radicale, disqualifiée et divisée en groupuscules, est toujours plus réduite. « Le pouvoir se gagne par les idées » ne fut pas qu’une simple phrase de campagne. Elle exprimait, au contraire, une volonté réelle de faire passer la tactique culturelle au tout premier plan de la stratégie de conquête du pouvoir. Objectif ? Accomplir une révolution culturelle de type « droitiste » et déstabiliser durablement les forces adverses. Aujourd’hui, c’est donc la civilisation de gauche qui est mise en péril. Pour continuer à exister en tant que telle, il lui faudra non seulement accepter cet état de fait mais aussi réinventer sa stratégie culturelle, face à un espace de représentation de la question sociale, dans lequel nous sommes désormais enfermés, pour un long moment.
[1] Antonio Gramsci (1891-1937), philosophe et théoricien politique italien, membre fondateur du parti communiste italien et célèbre auteur du concept d’« hégémonie culturelle ». Selon lui, les révolutions communistes prédites par Marx dans les pays industrialisés ne se sont pas produites en raison de l’emprise de la culture hégémonique bourgeoise sur les mentalités de la classe ouvrière. Le philosophe en déduit que la lutte politique doit d’abord passer par un combat culturel contre les valeurs bourgeoises, c’est-à-dire l’idéologie dominante.





Messages
1. L’étrange victoire des idées de droite, 24 juillet 2007, 19:02
Tu donnes du grain à moudre aux défaitistes de tout poil.
En Colombie, la droite a gagné parce qu’elle a assassiné l’opposition de gauche. Même chose au Brésil.
Dans les pays où le capitalisme et le libéralisme s’installent, la misère et la pauvreté gagnent du terrain durablement.
Depuis toujours, les capitalistes et les libéraux ont essayé de faire tomber l’URSS : guerres, isolement économique, étouffement des alliés, mises en place de dictatures de droite dans les pays du Sud et privatisations criminelles.
La droite n’a rien gagné du tout. Elle n’est même pas sportive. Les gens de droite sont aigris et haineux. Ils pensent que l’homme est fait pour ramper. Ils haïsssent la gauche et le communisme. Leurs méthodes sont des méthodes de gangsters. "Course" à la réussite. Course tout court. Il faut savoir s’arrêter. Il faut savoir faire passer l’humain avant tout le reste.
Ils n’ont pas gagné. Aux Etats-Unis, il existe des sociétés qui vivent comme les communistes.
mncds.
1. L’étrange victoire des idées de droite, 24 juillet 2007, 20:57
Merci pour ta réponse ! Nous sommes apparemment du même bord... mais mon article est un article d’analyse et je dois donc prendre acte de certaines réalités ce qui ne veut pas dire qu’une bataille perdue signifie la fin de la guerre.
Ce n’est pas une question de défaitisme mais de réalisme. L’idéologie de droite est bien la grande gagnante de ces élections (en fait ce n’est pas nouveau...) et oui elle a symboliquement et momentanément assassiné "l’opposition" de gauche par diverses tactiques effectivement de gangstérisme idéologique…
Enfin, encore faut-il nous entendre sur ce que nous mettons derrière le terme opposition/gauche : l’action du parti socialiste n’est plus, depuis longtemps, de gauche et ce que l’on a appelé la « gauche de la gauche » devient plus « une gauche de gauche ».
Le choix entre les deux candidats du 2ième tour revenait en apparence selon moi à choisir entre une droite molle et une droite dure sachant qu’à l’arrivée la politique mise en œuvre s’appuie sur le socle commun du néolibéralisme, appliqué dans la mesure de ce que la résistance sociale le permet dans un pays comme le notre.
De plus, je ne suis pas sur que le capitalisme et le libéralisme soit encore en train de s’installer dans quelque pays que se soit, il le sont déjà, de fait, depuis un long moment.
L’URSS était une dictature de gauche ce qui ne vaut pas mieux qu’une dictature de droite non ?
Et puis si les gens de droite « haïssent la gauche et le communisme » quant est-il de nous ? Mon sentiment à l’égard de l’extrême droite et de la droite en général ne relève pas de l’amour…
Quant au fait que « la droite n’a rien gagné du tout » je crains hélas que se soit l’inverse…
Pour gagner un match, la logique veut que l’on soit déjà au préalable qualifié parmi les participants mais l’essentiel n’est pas de participer puisque ici il ne s’agit pas d’un jeu… L’objectif est donc d’avoir les yeux en face des trous, de démonter la tactique de l’adversaire et de tirer droit au but.
Hasta la victoria... Salut à toi, humain !
TB
2. L’étrange victoire des idées de droite, 24 juillet 2007, 21:43
SARKOZYSME et BONAPAPARTISME.
Du louvoiement idéologique - bien décrit ici - et politique à la forte empreinte personnelle dans un régime politique sous tension.
Sarkozy ne peut être De Gaulle ou alors bien différemment. Est-il un nouvel avatar de ce que l’on a appelé bonapartisme ?
I - DIFFERENCIATION ETAT / REGIME POLITIQUE.
Nicolas BENIES in L’ Après libéralisme (1)
Dans les faits la politique d’austérité est contradictoire avec la nécessité pour le régime politique d’apparaître légitime aux yeux de la grande masse des citoyens . Les nécessités de l’accumulation obligent l’Etat à remettre en cause les conquêtes de la classe ouvrière, et donc à ne plus apparaitre comme l’arbitre entre les classes . C’est pourtant l’intérêt des régimes politiques.
Le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte
La différenciation Etat / régime politique est issue de l’analyse de Marx dans le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte qui montre que le régime politique incarnant l’Etat à un moment donné peut se constituer contre la bourgeoisie et s’appuyer sur la classe moyenne. C’est la quintessence de cet adage : "La bourgeoisie règne mais ne gouverne pas "(1), du moins le plus souvent. La bourgeoisie délègue ses pouvoirs politiques pour conserver l’essentiel : les rapports de production capitalistes. Ainsi, et Marx en fait une brillante démonstration le régime politique apparait au-dessus des classes alors que la nature de l’Etat reste capitaliste.
Cette analyse eminamment dialectique a été souvent mal perçue, beaucoup d’auteurs ont cru discerner deux définitions de l’Etat (2), alors que Marx part de la définition abstraite de l’Etat, "capitaliste collectif en idée", pour appréhender le régime politique qui représente la forme de l’existence de l’Etat. Il s’agit donc de deux niveaux d’abstraction différents, mais qui ne se conçoivent pas l’un sans l’autre.
Ce qui permet de comprendre que la politique étatique qui correspond aux nécessités de l’accumuation du capital, de sa valorisation, prime sur les nécessités de la légitimation. Car pour apparaître légitime, un gouvernement doit pouvoir satisfaire quelques revendications des travailleurs ("le grain à moudre" pour parler comme les dirigeants syndicaux réformistes) et, plus généralement, être perçu comme le garant des acquis, par l’intermédiaire de lois et donc du développement du droit, en particulier du droit du travail. Toutes choses qui expliquent l’abandon des politiques de relance keynésiennes, adéquates à la longue période decroissance mais qui ne répondent plus aux nécessités de l’accumulation en période de crise. Et aussi ce que les politologues appellent "l’usure des équipes au pouvoir", qui provient directement de la mise en oeuvre de la politique d’austérité, conduisant aux attaques répétées contre le niveau de vie et les conditions de travail de la majorité de la population. Ce n’est que pendant la période dite de prospérité (les "Trente Glorieuses", qui n’ont pas duré trente ans et n’ont pas été glorieuses, sinon pour l’accumulation capitaliste) que les impératifs de l’accumulation et de la légitimation ont pu coïncider.
(1) PEC La Brèche 1988 p 30 et 31
extrait de :
Du SOCIAL au POLICIER ou LE "DESORDRE POLICIER" AGGRAVE
http://www.bellaciao.org/fr/?page=article&id_article=48521
Est-il pertinent d’opérer pareil rapprochement ? Oui pour J Marseille.
II - BONAPARTISME - SARKOZYSME : un arbitrage spécifique entre les classes ?
A - Un exemple de rapprochement :
« Un bonapartisme moderne » par Jacques Marseille*
Importation du néoconservatisme américain, selon les plus paresseux de ses détracteurs, le sarkozysme est en fait ancré dans une tradition historique française. Pour faire court, il n’est rien d’autre qu’un bonapartisme moderne.
Ce qui le caractérise tout d’abord, c’est l’affirmation qu’il est possible d’être de droite en France. C’est épouser la pensée de Charles Péguy qui écrivait : « On ne saura jamais ce que la peur de ne pas paraître suffisamment à gauche aura fait commettre de lâchetés à nos Français. » Etre de droite pour brouiller les frontières entre soi-disant « progressistes » et soi-disant « conservateurs », telle est bien la marque de fabrique de cette droite sans complexe qu’on retrouve chez Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte ou Charles de Gaulle.
Ce qui en découle surtout, c’est la démonstration qu’il n’y a aucune incompatibilité entre le peuple et la droite, aucune complicité naturelle entre le peuple et la gauche, cette gauche du Front populaire qui, il faut le rappeler, a largement voté en 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Ecouter Nicolas Sarkozy parler aux travailleurs, c’est relire « L’extinction du paupérisme », dans lequel Louis-Napoléon Bonaparte écrivait, en 1844 : « La classe ouvrière n’est rien, il faut la rendre propriétaire. Elle n’a de richesse que ses bras, il faut donner à ces bras un emploi utile pour tous. Il faut lui donner une place dans la société et attacher ses intérêts à ceux du sol. » Contrairement à ce que prétendait François Hollande au cours d’un débat télévisé (avec l’auteur), ce n’est pas Jaurès qui a arraché le droit de grève pour les travailleurs, c’est Louis-Napoléon Bonaparte qui l’a accordé en 1864.
Ce qui caractérise enfin le sarkozysme, c’est l’optimisme qu’entraîne l’acceptation du monde tel qu’il est. C’est refuser de rétracter la France au rang de puissance moyenne et considérer avec les économistes libéraux que la mondialisation a toujours été une chance et non un cauchemar.
Autant de principes qui ne peuvent que nourrir les haines des partisans du prêt-à-penser. Difficile, en effet, pour tous ceux qui croient penser « juste », d’admettre un système qui fait de l’action et de l’adhésion populaire les clés de sa légitimité
* Historien
Le Point
B - Retour sur le contenu d’une notion :
- Extrait du "18 brumaire de Louis Bonaparte" de Karl MARX} }
Au Parlement, la nation élevait sa volonté générale à la hauteur d’une loi, c’est-à-dire qu’elle faisait de la loi de la classe dominante sa volonté générale. Devant le pouvoir exécutif, elle abdique toute volonté propre et se soumet aux ordres d’une volonté étrangère, l’autorité. Le pouvoir exécutif, contrairement au pouvoir législatif, exprime l’hétéronomie de la nation, en opposition à son autonomie. Ainsi, la France ne sembla avoir échappé au despotisme d’une classe que pour retomber sous le despotisme d’un individu, et encore sous l’autorité d’un individu sans autorité. La lutte parut apaisée en ce sens que toutes les classes s’agenouillèrent, également impuissantes et muettes, devant les crosses de fusils.
– Extrait des oeuvres de Léon TROTSKY 1933
Bonapartisme
L’adversaire du type d’Urbahns dira : il n’y a pas encore réellement de restauration du régime bourgeois, mais il n’y a déjà plus d’Etat ouvrier ; le régime soviétique actuel est un Etat bonapartiste au-dessus des classes ou entre les classes. En son temps, nous avons déjà réglé son compte à cette théorie. Historiquement, le bonapartisme fut et reste un gouvernement de la bourgeoisie dans les périodes de crise de la société bourgeoise. On peut et on doit distinguer le bonapartisme " progressif ", qui consolide les conquêtes purement capitalistes de la révolution bourgeoise, et le bonapartisme de déclin de la société capitaliste, le bonapartisme convulsif de notre époque (Papen-Schleiher, Dollfuss, le candidat au titre de bonaparte hollandais Colijn, etc.). Bonapartisme signifie toujours un louvoiement politique entre les classes ; mais, sous le bonapartisme dans toutes ses réincarnations historiques, se retrouve une seule et même base sociale : la propriété bourgeoise. Il n’y a rien de plus absurde que, des louvoiements bonapartistes entre les classes ou de la situation "au-dessus des classes" de la clique bonapartiste, conclure au caractère sans classe de l’Etat bonapartiste. Monstrueuse niaiserie : le bonapartisme n’est qu’une des variétés de l’Etat capitaliste.
Si Urbahns veut généraliser la notion de bonapartisme, en l’étendant aussi au régime soviétique actuel, nous sommes prêts à accepter une telle interprétation élargie — à une seule condition que le contenu social du " bonapartisme " soviétique soit défini avec la clarté nécessaire. Il est absolument vrai que l’absolutisme de la bureaucratie soviétique s’est formé sur le terrain du louvoiement entre les forces des classes, intérieures comme extérieures. Dans la mesure où le louvoiement bureaucratique fut couronné par le régime personnel et plébiscitaire de Staline, on peut parler de bonapartisme soviétique. Mais tandis que le bonapartisme des deux Bonaparte, comme celui de leurs lamentables rejetons actuels, s’est développé et se développe sur la base du régime bourgeois, le bonapartisme de la bureaucratie soviétique a sous lui le terrain d’un régime prolétarien. Les innovations de terminologie ou les analogies historiques peuvent présenter telle ou telle commodité pour l’analyse, mais ne peuvent changer la nature sociale de l’Etat soviétique.
Christian D
blog chrismondial
3. L’étrange victoire des idées de droite, 24 juillet 2007, 21:46
Merci pour ta réponse ! Nous sommes apparemment du même bord... mais mon article est un article d’analyse et je dois donc prendre acte de certaines réalités ce qui ne veut pas dire qu’une bataille perdue signifie la fin de la guerre.
— >En France, les idées de droite ont gagné du terrain pour CINQ raisons au moins :
— >le contrôle du grand capital sur les médias dominants. Cela fait belle lurette qu’on ne parle plus de socialisme à la télévision. Toutes les émissions sont prolibérales et procapitalistes. Dans une vraie démocratie, tous les problèmes seraient mis sur la table. Il y aurait de vrai débats.
— >une partie de la "gauche" n’a pas su résister au libéralisme. Les idées libérales et le capitalisme agissent comme un rouleau compresseur.
— >des idées de gauche qui sont laminées par la droite de manière démagogique. Les libéraux veulent que nous nous lancions dans la compétition internationale au risque de nous griller. Ecologie et droits des humains passent en dernier.
— >la gauche ne contrôle que très peu le secteur économique. Et pour cause, il y eut d’innombrables privatisations
Ce n’est pas une question de défaitisme mais de réalisme. L’idéologie de droite est bien la grande gagnante de ces élections (en fait ce n’est pas nouveau...) et oui elle a symboliquement et momentanément assassiné "l’opposition" de gauche par diverses tactiques effectivement de gangstérisme idéologique…
> Oui. Exemple : éditions de livres qui fusillent SR. Fouille de son appartement. On a constamment essayé de la rabaisser. Pourtant, il en a commis des bourdes le Sarko. En Europe et jusqu’à la deuxième guerre mondiale, les gouvernements socialistes ont été balayés par la droite. Il y eut de très nombreux assassinats. Il y eut des répression féroces. Le même phénomène se reproduit aujourd’hui dans certains pays d’Amérique du sud.
Enfin, encore faut-il nous entendre sur ce que nous mettons derrière le terme opposition/gauche : l’action du parti socialiste n’est plus, depuis longtemps, de gauche et ce que l’on a appelé la « gauche de la gauche » devient plus « une gauche de gauche ».
> Au PS, SR était pour un certain statu quo : pas de privatisations supplémentaires. Pas de baisse des impôts pour les riches. Aides aux PME, PMI. Lutte contre les OGM. Débat sur le nucléaire. Un programme écologique sérieux. Mise en place active de la culture du chanvre. Parcours profesionnel sécurisé. Genre de flexisécurité.
De plus, je ne suis pas sur que le capitalisme et le libéralisme soit encore en train de s’installer dans quelque pays que se soit, il le sont déjà, de fait, depuis un long moment.
> En Chine et en ex URSS, ils se sont installés récemment. On voit la différence au niveau des conditions de vie.
L’URSS était une dictature de gauche ce qui ne vaut pas mieux qu’une dictature de droite non ?
> l’URSS était un socialisme d’Etat avec ses qualités et ses défauts. Une majorité de russes estiment que le socialisme est supérieur au capitalisme. Il aurait fallu essayer de faire mieux encore : moins d’état, plus de coopératives socialistes.
Et puis si les gens de droite « haïssent la gauche et le communisme » quant est-il de nous ? Mon sentiment à l’égard de l’extrême droite et de la droite en général ne relève pas de l’amour…
>Déjà, il existe un vieux conflit entre les riches et les non riches. Je suis pour la supppression des héritages. Ou alors, tout le monde doit avoir les même chances à la naissance : même compte en banque, même patrimoine immobilier.
Quant au fait que « la droite n’a rien gagné du tout » je crains hélas que se soit l’inverse… Pour gagner un match, la logique veut que l’on soit déjà au préalable qualifié parmi les participants mais l’essentiel n’est pas de participer puisque ici il ne s’agit pas d’un jeu… L’objectif est donc d’avoir les yeux en face des trous, de démonter la tactique de l’adversaire et de tirer droit au but.
>
Il était assez facile de démonter l’argumentation de Sarko. Mais il a été porté par des vents favorables. Il a plein d’amis qui le soutiennent. Il a une femme qui le soutient. On lui écrit ses discours. Ses discours passent bien. Il a remporté quelques batailles : crises des banlieues, immigration. Identité nationale.
mncds
4. L’étrange victoire des idées de droite, 25 juillet 2007, 00:23
Cher Christian, merci pour cette approche/rapprochement complémentaire. Les théories que tu mets en œuvre ici éclairent richement et différemment la réalité que nous essayons de cerner.
Bonne lecture à tous !
TB
5. L’étrange victoire des idées de droite, 25 juillet 2007, 07:57
Enfin, encore faut-il nous entendre sur ce que nous mettons derrière le terme opposition/gauche : l’action du parti socialiste n’est plus, depuis longtemps, de gauche et ce que l’on a appelé la « gauche de la gauche » devient plus « une gauche de gauche ».
C’est OK, même les Trotskystes font du basique simple de défense des travailleurs, ce qui parait en ce jour effroyablement "gauchiste".... (..../....)
Au PS, SR était pour un certain statu quo : pas de privatisations supplémentaires. Pas de baisse des impôts pour les riches. Aides aux PME, PMI. Lutte contre les OGM. Débat sur le nucléaire. Un programme écologique sérieux. Mise en place active de la culture du chanvre. Parcours profesionnel sécurisé. Genre de flexisécurité.
Non, SR n’était pas pour un statu-quo.... Il ne faut pas confondre paroles lancées à un moment, choisies pour que tout le monde trouve son compte sauf ceux qui sont vigilants et sa position réelle dont on a entre-aperçu une série d’éléments, au lendemain de l’élection transparait sa pensée sur les 35 heures et le SMIG, témoins également, signalant de gigantesques problèmes de fond, sa recherche explicite de se passer de tout contrôle (la démocratie participative est le dernier avatar anti-démocratique pour que le(la) "chef" contourne la démocratie et s’adresse à une base atomisée et choisie. SR est blairiste et a développé une logique explicite du "sans comptes à rendre".
Par contre, il est exact que, après l’avoir monté au pinacle pour liquider les oppositions, le système médiatique sarkozien a fracassé SR. D’autant plus aisément qu’elle en avait été la grande bénéficiaire... Le temps qu’elle se réveille pour comprendre que la lune de miel était finie.....
En Chine et en ex URSS, ils se sont installés récemment. On voit la différence au niveau des conditions de vie.
Le développement formidable des inégalités sociales en Chine et en Russie impose de voir plusieurs phénomènes :
1) Il existait auparavant une formidable dissociation entre le niveau social de la caste dirigeante en URSS ou en Chine, et le au niveau social des Travailleurs et de la Paysannerie. Les questions bonnes à poser étaient le mode de redistribution des richesses produites par les travailleurs. Le capitalisme fait de l’appropriation individuelle, les systèmes russes ou chinois faisaient de l’exploitation et de la redistribution collective à une caste . En + ces systèmes niaient faire de l’inégalité sociale, les Dachas n’existaient pas, ni les cohortes de serviteurs de la caste, ni le chômage camouflé, ni la prostitution, etc. Donc des systèmes au concret d’inégalités sociales mais avec un coup de marteau pilon sur les outils de gestion .
Une grande partie des raisons de la transformation des castes dominantes Russes et Chinoises en Bourgeoisies vient d’ailleurs de l’inéficience de leur mode de domination, construit sur une tricherie beaucoup plus redoutable que la grossièreté transparente du capitalisme, construit sur des doubles, triples et quintuples comptabilités où plus personne ne sait où il en est .
2) Le système actuel en Chine conduit à des situations très contradictoires. Des zones entières sont dans un développement permettant indéniablement un progrès du niveau de vie populaire par rapport au passé, alors que par ailleurs des contre-poids apparaissent en matière de pollution et de développement trop anarchique (quoiqu’ils pourraient nous en montrer ...).
Ce n’est pas parce que les inégalités sociales augmentent en Chine que le niveau de vie de la population régresse .
l’URSS était un socialisme d’Etat avec ses qualités et ses défauts. Une majorité de russes estiment que le socialisme est supérieur au capitalisme. Il aurait fallu essayer de faire mieux encore : moins d’état, plus de coopératives socialistes.
Précisément, il a manqué le "pouvoir des travailleurs", la "tyrannie" de la majorité sociale.... Qu’est-ce qu’un socialisme sans pouvoir des travailleurs ?
Autre chose que le socialisme et d’abord un immense mensonge sur la réalité. Il faut là noyer le chat de l’idéologie pour voir les rouages concrets d’une société avec ses classes (paysannes, ouvrières) et ses castes hyper-hiérarchiques (les PC russes et chinois) qui reprennent bien des traits des systèmes de domination et d’oppression du passé et du présent .
Sans le pouvoir des travailleurs au concret (autogestion des entreprises), les libertés individuelles au concret, l’extinction des oppressions historiques cumulées (oppressions des femmes, des minorités, des homosexuels, etc), pas de socialisme mais autre chose qu’il faut définir par ses rouages concrets sans se faire abreuver de discours propagandistes, ne serait-ce que pour ne pas recommencer les mêmes conneries....
"Moins d’état et plus de coopératives..." Oui mais ça ne se fait pas comme ça et c’est une lutte de classe féroce contre la caste dirigeante (nomenclatura, bureaucratie, etc ). Ca a été tenté plusieurs fois dans l’histoire de ces sociétés où la classe ouvrière a éssayé de se glisser dans des interstices des contradictions du "pouvoir" pour prendre du poids et construire ses organes d’autogestion et de controle , ça c’est fini dans le sang....
On ne pouvait plus essayer de convaincre le PC Chinois ou le PC russe de faire le socialisme , le pouvoir des travailleurs au concret, impossible, tout autant qu’il n’est pas concevable d’essayer de convaincre la bourgeoisie de laisser le pouvoir.... Des Bourgeois peut -être mais pas la classe bourgeoise. De la même façon que dans les castes dominantes de ces états des individus furent de magnifiques opposants, mais la caste non réformable.
Il était assez facile de démonter l’argumentation de Sarko. Mais il a été porté par des vents favorables. Il a plein d’amis qui le soutiennent. Il a une femme qui le soutient. On lui écrit ses discours. Ses discours passent bien. Il a remporté quelques batailles : crises des banlieues, immigration. Identité nationale.
La droite avait perdu la bataille..... Il a fallu qu’elle réussisse à faire choisir la plus mauvaise des candidatures de gauche pour se réinstaller sur le cheval de l’avenir....
Sur l’identité nationale, un sondage a indiqué (avec tous le doute qu’on peut avoir sur ce type d’enquêtes) que la question nationale, à la façon dont Sarko et SR s’en étaient saisis n’avaient intéressés que 4% des Français, donc.....
Sur l’immigration, la question est bouclée depuis Jospin, la France n’accueille plus tellement par rapport à d’autres états, la crise des banlieues, rien de résolu....
C’est donc effectivement sur le ressenti que les Français se sont prononcés et pas sur ce qu’ils souhaitent, et encore moins sur la réalité des choses....
La bataille idéologique est toujours mésestimée , où sont les grandes télés sur le net de la sensibilité ouvrière ?
le PCF et la LCR rattrapent tout juste la capacité de n’importe quel adolescent boutonneux sur le net......Mais dépensent ne fric énormément (de quoi faire quelques centaines de sites....) pour faire survivre qui l’Huma papier, qui Rouge (pour ces derniers, qui lit ça ? Même pas leurs militants).....
Copas
6. L’étrange victoire des idées de droite, 25 juillet 2007, 16:00
"le 18 brumaire de louis bonaparte" de Karl Marx:présentation et nouvelle traduction de Grégoire Chamaillou,éditions Garnier -Flammarion,2007,6,80€
Traduction de Marcel Ollivier,introduction,chronologie et notesd’Emmanuel Barot et Jean Numa Ducange,éditions le livre de poche,5,50€
Traduction Maximilien Ruybel,éditions Gallimard,9,70€.
Trois nouvelles éditions 2007.Trois versions dans une conjoncture
Sarkosiste.Prémonition ?en tout cas c’est pas cher et ça peu rapporter gros..au lecteur !
Jean Claude des Landes
7. L’étrange victoire des idées de droite, 25 juillet 2007, 22:15
Salut Copas ! Tu as anticipé ma réponse à mncds… Je voulais justement lui répondre exactement sur les mêmes points avec un gros les mêmes idées…
Je souhaiterais en particulier revenir sur le positionnement politique de la candidature PS.
Bon d’abord soyons honnêtes, la France est peut-être l’un des derniers pays du monde occidental dans lequel la tradition d’une vraie gauche est encore palpable, toute marginalisée ou minoritaire qu’elle soit. Vu de l’extérieur (en particulier du monde anglo-saxon) nous apparaissons un peu comme les derniers des mohicans genre village d’Astérix… et l’évolution la plus basiquement prévisible de l’échiquier politique s’achemine vers un bipartisme où la gauche se ramassera en une entité en gros équivalente au parti démocrate au Etats-Unis, au parti travailliste en GB ou au SPD en Allemagne.
Il faut donc selon moi prendre en compte le prisme « déformateur » de notre contexte national. Lorsque nous glissons de l’expression « gauche de la gauche » à « gauche de gauche » (ou inversement) ce n’est pas innocent. C’est une façon de reformuler/écraser la réalité politique et de déplacer le curseur selon un positionnement et une vision du monde spécifique, dans un sens comme dans l’autre.
Ce mea culpa accompli, il faut je crois revenir à se sujet sur les fondamentaux :
Entretien avec Bourdieu, Télérama du 12/08/98 :
TRA : La subversion, ce pourrait être pour vous un projet politique ? Quel est votre rôle exact dans cette liste " gauche de la gauche " qui se constitue, dit-on, sous votre parrainage pour les prochaines élections européennes ?
P.B. : Tout ça n’est qu’invention, malveillante le plus souvent, de journalistes. Nous avons parlé d’une "gauche de gauche " (et non de la gauche), c’est-à-dire, tout simplement, d’une gauche vraiment de gauche, d’une gauche vraiment respectueuse des promesses qu’elle a faîtes pour obtenir les suffrages des électeurs de gauche - en matière de droits accordés aux étrangers ou aux homosexuels, par exemple. Parler de " gauche de la gauche ", comme l’ont fait spontanément les journalistes, c ’est transformer une intervention presque banale - n’est-il pas normal, de la part des électeurs, de rappeler les élus à leurs engagements ? - en prise de position radicale, extrémiste, facile à condamner. De là à inventer que des chercheurs, dont ce n’est pas le métier, vont s’engager dans la lutte politique, il n’y a qu’un pas.
Cette histoire illustre parfaitement mes analyses du champ journalistique qui réduit les prises de position intellectuelles à des choix politiques, qui ne connaît que les opinions tranchées, organisées selon ses propres catégories, droite/gauche, gauche/extrême gauche, qui ne comprend pas ou ne lit pas ce qui s’écrit et finit par interdire toute intervention analytique dans le jeu politique. La déformation systématique que le journalisme fait subir aux propos publics des chercheurs - et la résistance forcenée qu’il oppose aux démentis et aux mises au point, exerçant ainsi une véritable censure - n’encourage pas beaucoup les chercheurs à intervenir. Je sais que ces propos vont choquer (au moins les journalistes et, surtout, ceux qui s’efforcent de contribuer à ouvrir un espace de discussion). Mais il s’agît de sujets trop graves pour qu’il soit possible de se contenter des échanges habituels de politesse hypocrite.
Tout cela n’est donc pas qu’une question de positionnement politique (« idéaliste », « irréaliste », « naïf », « franco-gauchiste ») une définition simple, objective et connue de tous de la différence entre la droite et la gauche consiste à poser d’un côté la droite comme l’agent des classes supérieures et la gauche comme l’instance de défense des classes populaires. Les droits/acquis sociaux d’aujourd’hui sont dans leurs grandes lignes issus des luttes politiques d’hier menées par les organes politiques de gauche, nous le savons tous.
Ceci posé, comment dès lors situer le parti socialiste aujourd’hui ? Des éléments de réponse sont notamment donnés par le père Bourdieu et consort : Christophe Charle, Bernard Lacroix, Frédéric Lebaron et Gérard Mauger dans un texte militant et fondateur paru déjà il y a presque 10 ans :
Pour une gauche de gauche, Le Monde, 08/04/1998.
Il est temps que le quatuor Jospin, Chevènement, Hue, Voynet se rappelle que les majorités de gauche ont conduit au désastre chaque fois qu’elles ont voulu appliquer les politiques de leurs adversaires et pris leurs électeurs pour des idiots amnésiques.
Quinze jours après le vendredi noir des élections aux présidences régionales, les guérisseurs en tout genre s’affairent au chevet de la République. Pour l’un, un changement de régime électoral permettrait à la démocratie de retrouver ses belles couleurs modérées. Pour un autre, juriste savant, une révision du système électoral remettrait en état de marche une démocratie paralytique. Pour un troisième, ancien ministre et fin stratège, c’est l’absence d’un "centre" qui a transformé l’Etat en bateau ivre, oscillant de droite à gauche et de gauche à droite, au risque de sombrer à l’extrême droite.
Le plus haut personnage de l’État, dans un rôle de père noble un peu trop grand pour lui, tance les partis comme des gamins turbulents et promet le changement de règle qui permettrait au jeu de reprendre sans les skinheads. Un ancien candidat à la présidence de la République, dans un éclair de lucidité tardive, se demande si les électeurs n’en ont pas assez de revoir depuis trente ans la même comédie. Les experts en résultats électoraux évaluent au pour cent près les potentiels électoraux des nouvelles coalitions en gestation. Les trois derniers présidents de région mal élus plastronnent déjà sur les plateaux de télévision : loin d’être des otages, ils sont des remparts, ils n’ont embrassé le Front national que pour mieux l’étouffer. Pour un peu, ils convieraient leur conseil régional à voter d’urgence l’érection de leur propre statue, histoire d’aider les artistes locaux, la culture régionale et le civisme républicain.
Mais devant le triste spectacle de nos médicastres politico-médiatiques, la dérision ne suffit pas. La réponse "nouvelle"qu’ils prétendent apporter à la fascisation d’une partie de la classe politique et de la société française est à leur image, superficielle.
Ils restreignent le cercle des questions gênantes au vade-mecum habituel du futur candidat à la prochaine élection : comment ne pas perdre les européennes, comment préparer les législatives en cas de nouvelle dissolution, à quel nouveau parti vaut-il mieux adhérer ? Et bientôt : comment rallier les voix du centre en déshérence ? etc. C’est cette conception de la politique qui est depuis plusieurs années l’alliée la plus sûre du FN : instrumentale et cynique, plus attentive aux intérêts des élus qu’aux problèmes des électeurs, elle n’attend de solution que de la manipulation des règles du jeu électoral et médiatique.
Les vraies questions sont d’une tout autre ampleur : pourquoi, en moins d’un an, la gauche "plurielle" a-t-elle cassé la dynamique de sa victoire à l’arraché alors qu’elle n’a pas même l’alibi d’indicateurs économiques en déroute ? Pourquoi a-t-elle suscité des déceptions dont ses résultats électoraux interprétés comme des victoires ne donnent qu’une faible idée ? Pourquoi, par exemple, tant de suffrages pour les organisations qui se veulent ou se disent hors du jeu politique ? Pourquoi une partie de la droite en perdition préfère-t-elle se radicaliser alors qu’elle est au pouvoir à travers une gauche qui réalise tous ses rêves ?
Avec sa tentation extrémiste, la droite rejoue une partie déjà perdue par le centre et la droite allemands au début des années 30, sous la République de Weimar. L’Etat impotent suscite l’indifférence massive des électeurs pour la République : il est clair qu’on ne va pas voter pour répartir des prébendes, étouffer des scandales, vendre des services publics au plus offrant, s’en remettre à des bureaucraties inamovibles et inaccessibles, nationales et internationales.
En implosant, la droite française retourne aux origines troubles du régime qu’elle a fondé. Quand les conservateurs ne savent plus quoi conserver, ils sont prêts à toutes les révolutions conservatrices. La persistance du succès électoral d’un parti comme le Front national, dont le programme appliqué ferait la ruine de ses électeurs les plus démunis, n’exprime souvent rien d’autre que l’aversion à l’égard d’un personnel politique obstinément sourd et aveugle au désarroi des classes populaires.
Les faux-semblants de la gauche "plurielle" déçoivent les électeurs de gauche, démobilisent les militants, renvoient vers l’extrême gauche les plus exaspérés. Il n’est guère étonnant que les premiers à protester aient été les premiers floués de la démagogie "plurielle" d’une gauche vraiment singulière : les sans-papiers, les chômeurs, les enseignants.
Une réforme électorale ne suffira pas à calmer les revendications auxquelles des ministres répondent par la charité ostentatoire, le saupoudrage calculé ou les tours de passe-passe rusés. Quand ils ne se laissent pas aller à des outrances verbales arrogantes ou démagogiques, toutes à l’opposé de la générosité enthousiaste d’un message mobilisateur, voire à des pratiques tragiquement semblables à celles de leurs prédécesseurs.
La gauche officielle a bien du mal à se débarrasser de l’héritage douteux du mitterrandisme. Elle irrite ses fidèles sans pouvoir attendre de ses ennemis le moindre signe de satisfaction. Elle profite provisoirement de la médiocrité de ses adversaires sans proposer autre chose qu’une politique au jour le jour qui ne change rien d’essentiel dans la vie quotidienne de la grande majorité des citoyens. Le jour du bilan, peut-être plus proche qu’elle ne croit, avec la menace de nouveau disponible de la dissolution, que pourra-t-elle invoquer pour mobiliser les abstentionnistes, les dissuader de voter pour le FN ? Les emplois-jeunes pour quelques-uns, les 35 heures en peau de chagrin, la rigueur ininterrompue, une réforme de l’éducation transformée en show ministériel, la fuite en avant vers l’Europe des banquiers ? Croit-on pouvoir tromper longtemps l’attente d’une Europe sociale avec une "gauche plurielle européenne" animée par la troïka néo-libérale Blair-Jospin-Schröder ?
La gauche de base croit encore à la République sociale : il est temps que le quatuor Jospin, Chevènement, Hue, Voynet se rappelle que les majorités de gauche ont conduit au désastre chaque fois qu’elles ont voulu appliquer les politiques de leurs adversaires et pris leurs électeurs pour des idiots amnésiques.
Les vraies réponses à la fascisation rampante ou déclarée ne peuvent venir que des mouvements sociaux qui se développent depuis 1995. A condition que l’on sache les entendre et les exprimer au lieu de travailler à les déconsidérer par la diffamation publique ou les coups fourrés d’anciens apparatchiks politiques convertis en hommes d’appareil d’Etat. Ils suggèrent en effet des perspectives politiques et avancent même parfois des projets et des programmes constitués.
La pression locale, dans certaines régions de gauche, a contribué à rappeler à la raison la droite la moins aveugle. Les manifestations anti-FN témoignent d’une capacité militante qui ne demande qu’à défendre des causes plus ambitieuses que le seul refus du fascisme. Le mouvement pour le renouveau des services publics - et notamment pour une éducation nationale plus juste, tel qu’il s’exprime aujourd’hui en Seine-Saint-Denis - est à l’opposé de la crispation identitaire sur une institution archaïque : il affirme la nécessité de services publics efficaces et égalitaires dans leur fonctionnement et dans leurs effets.
Le mouvement des sans-papiers, voué aux gémonies par les "responsables" de tous bords, est une résistance collective face à la politique obtuse qui, au nom de la lutte contre Le Pen, prend souvent ses idées et ses armes chez Le Pen (avec le succès que l’on sait...). Le mouvement des chômeurs apparaît comme une "lutte tournante", sans cesse recommencée contre les effets destructeurs de la précarisation généralisée. Les mouvements récents contre l’AMI et pour la taxation des capitaux témoignent de la montée en puissance de la résistance au néolibéralisme : elle est, par nature, internationale.
Ces forces que nos professionnels de la manipulation suspectent d’être sous l’emprise de manipulateurs extérieurs sont encore minoritaires mais, déjà, profondément enracinées, en France comme dans d’autres pays européens, dans la pratique de groupes militants, syndicaux et associatifs. Ce sont elles qui, en ’internationalisant, peuvent commencer à s’opposer pratiquement à la prétendue fatalité des "lois économiques" et à humaniser le monde social. L’horizon du mouvement social est une internationale de la résistance au néolibéralisme et à toutes les formes de conservatisme.
Ou encore pour clôturer ce message :
"D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française", Didier Eribon, Editions Léo Scheer, 2 avril 2007 :
« Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, en mai 1981, une bonne partie de ceux qui avaient participé aux mouvements de contestation des années 1960 et 1970 ont considéré cette victoire comme étant un peu la leur. Et surtout, ils ont pensé qu’un « travail en commun » pourrait se mettre en place : au contact de toutes ces énergies sociales et culturelles, les socialistes allaient inventer un nouvel art de gouverner, qui permettrait de réconcilier la critique radicale et la réforme, la mobilisation et la transformation effective. Il leur fallut bientôt déchanter : les socialistes furent vite changés par l’exercice du pouvoir et se mirent à dénoncer comme des ennemis les mouvements sociaux et les intellectuels qui les soutenaient. Dans le même temps, s’opérait un glissement général vers la droite de toute la vie intellectuelle française, qui fut produit dans une large mesure par le travail de cénacles idéologiques et d’universitaires qui se donnèrent pour tâche d’effacer l’héritage de Mai-1968 et des années 1970. Ces promoteurs d’une véritable restauration conservatrice façonnèrent un cadre de référence qui devint en même temps celui de la gauche socialiste et de la droite la plus traditionnelle. C’est assurément le divorce qui s’installa alors durablement entre une gauche officielle récitant le catéchisme de la pensée réactionnaire et une gauche critique renvoyée à une radicalité sans débouchés qui explique la défaite du candidat socialiste à l’élection présidentielle de 2002. »
C’est de cette séquence - mais surtout de ses conséquences actuelles - que Didier Eribon entreprend ici l’analyse à la fois historique, théorique et politique, en plaidant pour la renaissance d’une « gauche de gauche », et pour un renouveau de la pensée critique* (*dixit Editions Léo Scheer) :
« Parler de « gauche de la gauche » présuppose en effet qu’il y aurait d’un cote une « gauche » et de l’autre des courants qui se situent à la gauche de celle-ci. Or ce n’est pas ce que voulait dire Bourdieu [...]. Et ce n’est pas ce que nous avons sous les yeux aujourd’hui : Ce qui est désigné comme la gauche n’est plus la gauche et, par conséquent, il ne s’agit pas de faire exister une « gauche de la gauche » mais de redonner vie a une gauche tout court.
Car contrairement à l’image qui s’est formée et qui a été largement inventée par des campagnes fort intéressées [...] Bourdieu n’a jamais plaidé pour une gauche « radicale » opposée à une gauche « réformiste » ou pour la création d’une « gauche de la gauche » opposée a la « gauche ».
Il suffit de le lire pour voir qu’il insistait toujours, contre les radicalismes intransigeants, contre les logiques du tout ou rien, pour des reformes réalistes, qu’il savait ne pouvoir être que modestes. Qu’il ait pu apparaître comme le chantre exalté d’un extrémisme militant alors qu’il défendait les droits sociaux acquis et se mobilisait pour de nouveaux droits et de nouvelles libertés, comme aurait du le faire toute la gauche si elle était restée de gauche, montre simplement a quel point la gauche avait dérivé vers la droite. Ce qui signifie sans doute, puisque ce qui a été désigné comme « la gauche de la gauche » c’est tout simplement la gauche, que ce qui s’est présenté comme la « gauche » (en opposition a la « gauche de la gauche ») pourrait être appelé la « droite de la gauche » ou, plus simplement, une « gauche de droite ».
On conçoit des lors la colère de Bourdieu contre ceux qui avaient spontanément modifié (et continuent de le faire) l’expression « gauche de gauche » en « gauche de la gauche » car, outre que cela consistait a tout réduire à la seule question des rapports entre différents partis et organisations (ou entre différents candidats dans les compétitions électorales) au lieu de considérer que le problème était celui des rapports entre les différents partis et les demandes sociales, cela revenait surtout à réintroduire une frontière là où il s’était agi pour lui de montrer que cette coupure, pour n’être pas totalement fictive, était précisément ce qu’il convenait de défaire : surmonter 1’opposition entre gouvernement et mouvements, reforme et critique, réalisme et radicalité, etc.
Pour que des formes de dynamiques collectives, en tout cas de volontés mises en commun, permettent d’éviter 1’installation - avec toutes les conséquences évidentes et pour la gauche institutionnelle et pour la gauche radicale - d’une scission permanente et insurmontable entre une gauche de gouvernement qui fait la politique de la droite et une ultra-radicalité purement oppositionnelle, et la plupart du temps sans résultats concrets.
Bourdieu voulait donc réfléchir a la manière dont la gauche pourrait rester au gouvernement (et donc travailler aux reformes) et la demande sociale rester ce qu’elle est (par définition revendicatrice et critique, multiforme et imprévisible), tout en sortant des situations qui ne peuvent conduire la première qu’a la défaite électorale et la seconde qu’a se complaire dans une subversion - verbale - incantatoire et dans une exaltation spontanéiste d’explosions populaires sans autres débouchés qu’elles-mêmes et dont les acteurs sont, hélas, voués a l’impuissance et au désespoir, quand ils ne sont pas, plus simplement, soumis a une répression brutale.
Au lieu d’insulter Bourdieu comme ils le firent avec une constance et une véhémence, dont ils ne s’apercevaient même pas qu’elles se retournaient centre eux et contribuaient à les discréditer aux yeux de ceux qui auraient pu les soutenir, les hiérarques du Parti socialiste et tous ceux qui les ont applaudi, eussent été mieux inspirés de 1’écouter et de réfléchir à ce qu’il essayait de leur faire comprendre.
Mais il était trop tard sans doute. Le Parti socialiste ne voulait plus - et ne pouvait plus - entendre ni même écouter les intellectuels critiques. Ce qui se passa le 21 avril 2002 découle de cette surdité, elle-même produite par vingt ans de dérive conservatrice. L’issue était donc fatale. Et au lieu de considérer qu’ils avaient fait fausse route a tous égards, les socialistes imputèrent leur échec et le désastre qu’ils avaient provoqué à ceux qui les avaient mis en garde et pressés de se ressaisir.
8. L’étrange victoire des idées de droite, 25 juillet 2007, 22:58
Si, l’huma est lue attentivement. Ce journal n’est pas assez diffusé.
Il faut arrêter de taper sur tout ce qui bouge.