Accueil > Une réponse de chercheurs précaires a Mr. Trautmann
Une réponse de chercheurs précaires a Mr. Trautmann
Publie le mardi 24 juin 2008 par Open-Publishing9 commentaires
Suite a ce texte : "SLR t’appelle...
Mr Trautmann a répondu :
Bonjour
J’ai mis votre texte sur le site.
Je comprends votre amertume, mais je ne crois pas qu’opposer précaires et titulaires puisse apporter la moindre solution.
La solidarité, oui (même si elle est, hélas, bien rare). La division, non.
Bien cordialement
Alain Trautmann
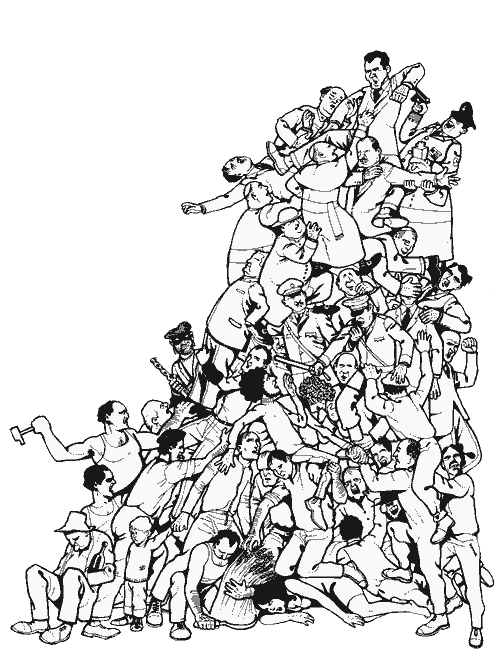
La solidité d’une chaîne dépend de son maillon le plus faible...
Mr Trautmann, j’ai grand respect pour votre travail et pour votre action ; néanmoins je crois que vous ne comprenez pas notre amertume. Notre, car nous sommes très nombreux, à avoir marché avec vous et à ne plus le faire. Cela se sent très bien dans la mobilisation (et cela n’a pas échappé au pouvoir en place).
Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne vivez pas (depuis et pour des années)…
L’impossibilité de vivre d’un travail qui nous prend entièrement nos vies familiales et sociales.
La quasi-impossibilité pour les femmes de faire des enfants sereinement avant d’être recrutées. Je vous passe les histoires sordides (suicides et autre) inutile de faire pleurer dans les chaumières.
Pensez seulement, en tant que scientifique-devant-faire-ses-preuves (pendant 10 ans, parfois plus) à l’obligation de donner la paternité de travaux aux rois UBU des labos, se taire sur le plagiat, la désinformation sur les risques sanitaires, la fraude scientifique, ou les mascarades scientifico-académiques, l’obligation d’avaler toutes les couleuvres, ces humiliations en échange de médailles en chocolat. Monsieur, par solidarité, avez-vous déjà vécu de défraiements, de carte de photocopies et de livres gratuits ? Imaginez-vous seulement la peur que nous pouvons ressentir à vieillir dans ces conditions… ? Ce ne sont pas des invectives personnelles, mais c’est notre réalité.
Ces choses et bien d’autres durent, vous les avez peut être connues en votre temps mais croyez nous, ce n’est pas une bohème ou une initiation surtout quand ces situations durent des années dans les conditions que nous vivons jour et nuit…
De l’intérêt “d’opposer” titulaires et précaires : aucun, je suis bien d’accord avec vous.
Cependant, vous en conviendrez que la plupart des titulaires acceptent que nous fassions le même travail qu’eux (voire bien plus) pour des promesses, rien, et finalement si peu.
Certains titulaires ignorent ou feignent franchement d’ignorer qu’un grand nombre de précaires travaille à ses cotés depuis des années.
Certains « militants » de la cause de la recherche sont des mandarins et se fichent éperdument du sort de leurs petits thèsards, ou post doc, ATER à mi-temps et autres intermittents de la recherche.
Nous sommes sous la coupe de ces gens qui laissent la sélection académique se faire bonant malant sur concours d’allégeance à leur petite personne.
Les mouvements de chercheurs n’évoquent que très rarement et plutôt en fin de tract le sort des précaires, c’est un peu court après 4 ans...
En 2004, il y avait beaucoup de précaires dans la rue (jeunes et vieux). Nous avons marché pour vous. Comment expliquez vous aujourd’hui la quasi-absence des précaires dans votre mouvement ?
Manque de solidarité. Que s’est il produit en 4 ans ? Combien parmi ceux là sont encore en grande précarité ? Nous sommes trop invisibles, inaudibles, inconsistants, trop mobiles d’un lieu et d’un espace du savoir à l’autre. Aucun syndicat ou asso si respectable qu’ils puissent être ne nous défendra… Alors nous venons simplement vous rapeller ce hiatus entre ce que vous prônez "pour la recherche" et la manière dont les titulaires seniors administrent leurs labos depuis des années.
Suite à 2004, vous, nos chefs, avez accepté des crédits de la nouvelle ANR. Combien de mandarins de toutes les démissions administratives et pétitions de principe ont capté des places dans cette "chose" ? Combien se sont arrangé entre amis pour faire monter leurs carrieres individuelles sur la base d’appels d’offre rédigés par des précaires ? Combien siègent au CNU ou à la CPU à présent, ou servent d’experts ad-hoc au gouvernement ? Combien d’entre eux se sont restés silencieux face à la LRU, ont accepté il y a quelques mois de participer aux mascarades entre-soi, de la toute fraîche AERES ? Qui accepte le plan CAMPUS financé par la privatisation de EDF ? En somme, qui doit-on sauver, certains de ceux qui nous oppriment ?
Pire encore, certains mandarins et autres opportunistes à courte vue anticipent et se frottent les mains. Ils comprenent très bien que les dérogations de droit privé qui leur permettront de créer de petites filiales bien juteuses, toutes prêtes à suivre les financiers donneurs d’ordres. Ces gens formés sur dénier public par et pour le service public. Devons-nous encore leur servire de marche pied par solidarité.
Alors je vous pose la question. Si demain le CNRS n’est pas démantelé, l’université n’est pas privatisée, que l’enseignement secondaire et primaire sont réstaurés, en somme que les engagements régaliens de l’états sont pérennisés et respectés, pensez-vous que les titulaires resteront mobilisés pour nous ? Non, car une partie de nos intérêts divergent, beaucoup de titulaires dépendent du travail gratuit des précaires, beaucoup de précaires connaissent les "petits arrangements" de leurs patrons titulaires.
Aussi , les contractuels le resteront, profs auxiliaires de remplacement, pigistes de la recherche, les précaires de toute sorte continueront à faire tampon. Nous n’en serons pas satisfait, car justement nous sommes solidaires mais pas seulement des chercheurs. La solidarité n’est pas à sens unique... L’information doit sortir. On ne peut pas prétendre sauver la recherche sans s’occuper en priorité de cette honte qu’est l’académie (avec ses esclaves pour la cause, ses concours notoirement bidons au CNRS et dans les facs, l’exploitation dans les labos mais aussi dans les média et la culture). On ne peut pas prétendre à donner des leçons de solidarité et d’ouverture quand on accepte le culte de la concurrence et l’hyper-spécialisation comme credo de formation des chercheurs tout en pérorant sur la collaboration et l’ouverture...
À moins que par solidarité vous ne vous engagiez clairement dans ce sens, en commençant à causer avec les précaires qui sont peut-être chez vos collègues, chez vos éditeurs, chez les journalistes qui viennent vous interroger. En nous aidant à sortir de l’anonymat sans risquer de perdre le peu ou le pas grand chose néanmoins vital.
Concrètement, dans le secteur de la recherche par exemple :
Pourquoi ne pas intervenir pour les docteurs et doctorants étrangers en France qui connaissent des situations incroyables. Il y a aussi des sans papiers en troisième cycle. Alors, pourquoi ne pas exiger la fin du décret n° 87-889 du 29 oct. 1987 qui interdit les postes temporaires aux chômeurs de troisième cycle ou docteurs de plus de 28 ans et les réserve aux titulaires ou déjà en poste ? Vous savez que ces deux seules situations entraînent des abus et injustices en cascades (usage de faux contrats de travail, népotisme, marchandages des heures au noir avec des précaires, et là encore il y a bien à dire…).
En ce qui concerne les doctorants, pourquoi ne pas revendiquer (pas seulement en pétition) la fin du travail au noir des doctorants et post-doc sous forme de libéralités (bourses) sans droits, sans sécurité sociale ?
En somme, pourquoi ne pas commencer par nous défendre en comprenant bien que nos positions de faiblesse extrême vous affaiblissent tous comme le maillon de la chaîne...
C’est donc très regrettable mais nous devons vous imposer notre solidarité et notre existence pour exister. Il ne s’agit pas seulement de nous, ni de nos amis. Tout cela va bien au-delà de la recherche et de l’académie, c’est de notre société qu’il s’agit. Ces problèmes nous concernent et nous touchent tous parce que les savoirs et les technologies déterminent les orientations de la société et en alimentent autant les progrès que les catastrophes.
Bien cordialement,
Nous, précaires du/des savoir/s
PS J’ai également mis votre réponse sur le site…





Messages
1. Droits des doctorants, 25 juin 2008, 11:57, par Eric
Suite à mes commentaires dans le fil "opposer précaires et titulaires", il me semble qu’il est également utile de lire cet article de novembre 2007 :
Saura-t-on un jour la valeur légale de la Charte des Thèses ?
Valérie Pécresse continue à faire publiquement l’éloge de la politique suivie depuis mai dernier dans l’enseignement supérieur et la recherche. Mais les actuelles mobilisations contre la loi dite « d’autonomie des universités » fournissent une excellente occasion pour rappeler que, dans ce domaine du secteur public, les hiérarchies et les groupes influents ont déjà beaucoup trop d’autonomie à l’égard de pouvoirs et contrôles publics. La question de la Charte des Thèses nous en fournit un nouvel exemple.
Les « larges consensus » de fait qui ont suivi l’élection de Nicolas Sarkozy le 6 mai et la formation de gouvernements « transversalisés » avec la participation de « personnalités de gauche » ont étouffé jusqu’à récemment le mécontentement que devait inévitablement susciter la loi Pécresse. Car quiconque connaît le fonctionnement réel des institutions de la recherche et de l’enseignement supérieur aura plutôt tendance à s’étonner de l’immunité des coupoles et des administrations influentes. Ce que la loi Pécresse ne fera qu’aggraver.
Et la polémique déclenchée par la référence récente à de possibles liens entre Paris Biotech Santé et l’Arche de Zoé, voir :
http://www.voltairenet.org/article152777.html
http://www.parisbiotech.org/pbs6
http://www.voltairenet.org/article152874.html
ne témoigne-t-elle pas, par elle-même, d’un certain défaut de contrôle administratif et citoyen des structures mises en place à partir des organismes scientifiques publics ?
C’est en tout cas, entre autres, d’un manque d’efficacité des contrôles administratifs que l’on peut, pour le moins, se plaindre dans l’affaire de l’amiante de Jussieu :
http://amiante.eu.org
http://www.lepetitjournal.com/content/view/20257/204/
Comment a-t-on pu laisser la situation dériver, au point que de nombreux décès liés à l’amiante ont déjà eu lieu, et qu’en janvier 2005 trois établissements du site de Jussieu (les Universités Paris 6 - Pierre et Marie Curie et Paris 7 - Denis Diderot, ainsi que l’Institut de Physique du Globe) ont été mis en examen pour mise en danger d’autrui ? On peut craindre que l’une des sources du problème ne réside, précisément, dans un excès d’influence, d’autonomie et d’immunité de la part des « sommités ».
L’influence des hiérarchies universitaires et scientifiques tient, notamment, à leur osmose avec les plus hautes instances de l’Etat et avec les organes dirigeants du secteur privé et du monde politique. Mais dans ce cas, que peut faire un « petit doctorant » confronté à un litige avec son laboratoire d’accueil ? Wikipédia dresse un tableau trop optimiste en écrivant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/École_doctorale
« Les écoles doctorales : (...) s’assurent de la qualité de l’encadrement des doctorants par les unités et équipes de recherche, veillent au respect de la charte des thèses prévue par l’arrêté du 3 septembre 1998 et la mettent en oeuvre. »
La Charte des Thèses est le résultat d’un arrêté :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recherche/formation/charte.htm
pris devant la prolifération de situations de véritable détresse des étudiants de doctorat. Chaque université est censée avoir adopté une Charte des Thèses, laquelle est souvent mise en ligne sur son site. C’est le cas, par exemple, de l’Université Paris 7 - Denis Diderot :
http://www.univ-paris-diderot.fr/chartethese.htm
Mais quelle est la portée légale de cette Charte ? L’arrêté de 1998 parle bien d’ « application de la charte » et de « dispositions », et propose une « charte type » où il est écrit notamment : « Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence ». Il est prescrit ensuite, par exemple : « Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de thèse, qui s’engage à lui consacrer une part significative de son temps. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l’accord initial ». Une disposition qui ne peut que déranger un certain nombre de « personnalités » qui, tout en apparaissant officiellement comme les directeurs de thèse, « délèguent » dans la pratique leurs tâches d’encadrement à d’autres chercheurs. Malgré son caractère très « minimal », qui n’est qu’un rappel des obligations normales de toute université et de tout directeur de thèse, la Charte des Thèses s’est toujours heurtée à de fortes réticences de la part d’établissements et responsables qui ont été jusqu’à mettre en cause son caractère contraignant.
Or, le 8 janvier 2004, une vice-présidente de section du Tribunal Administratif de Paris déboutait par ordonnance (dossier 0311110) une doctorante qui réclamait l’application de la Charte des Thèses de son université. Pour justifier cette décision, prise au titre d’une prétendue « irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance », la magistrate a écrit : « s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet d’établir une relation contractuelle entre les signataires ». Raison pour laquelle, d’après le Tribunal, un éventuel refus d’appliquer la Charte des Thèses « ne saurait présenter le caractère d’une décision administrative faisant grief et n’est pas de nature à être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». Mais la doctorante avait plaidé le caractère réglementaire de la Charte, et pas un quelconque caractère contractuel. Un moyen auquel l’ordonnance ne répondait pas. L’intéressée a donc fait appel de la décision du Tribunal Administratif.
Le 11 juillet 2004 (date du Journal Officiel), le Ministre délégué à la Recherche François d’Aubert, en réponse à une question écrite (38911, J.O. du 11 mai 2004) de l’alors député André Santini, reconnaissait la valeur réglementaire de la Charte des Thèses avec ces mots : « Si elles n’ont pas valeur contractuelle, les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement ». Pourtant, le 30 novembre 2006, la Cour Administrative d’Appel de Paris déboutait à nouveau la doctorante par ordonnance (dossier 04PA02718) du président de sa 4ème Chambre, confirmant l’irrecevabilité manifeste prononcée en première instance. Motif invoqué : la Charte des Thèses « ne contient aucune obligation contraignante tant pour le directeur de thèse que pour le doctorant ». La requérante a de surcroît été condamnée, par cette ordonnance et malgré une situation financière très difficile, à payer un total de 1500 euros de frais d’avocat de deux universités et d’un organisme de recherche.
Lorsque l’intéressée, qui ne dispose pas de ressources pour payer un avocat au Conseil d’Etat, a tenté de se pourvoir en cassation estimant que le caractère réglementaire de la Charte est bien réel et comporte des obligations pour l’Université, le laboratoire, l’école doctorale et le directeur de thèse, sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par ordonnance du président du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Conseil d’Etat, au motif d’une « absence de moyens sérieux susceptibles de convaincre le juge de cassation ». Pourtant, on aurait pu penser que la question de la valeur réglementaire de la Charte des Thèses et des obligations qu’elle comporte à ce titre est suffisamment importante pour être jugée en cassation par la Section du Contentieux, et pour qu’une « petite justiciable » sans ressources suffisantes ne se heurte pas à une barrière financière.
Sauf « miracle économique », la requérante ne pourra pas régulariser en temps utile son pourvoi en cassation, faute de moyens financiers, et la question de fond que cette situation soulève ne fera pas l’objet d’un arrêt motivé de la Haute Juridiction.
Universitaire 1995
universitaire1995@yahoo.fr
AuteurE(s) : Universitaire 1995
Mis en ligne le lundi 12 novembre 2007 à 00:00.
1. Droits des doctorants, 25 juin 2008, 11:59, par Eric
A ce jour, l’intéressée se voit toujours refuser l’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation qu’elle a malgré tout introduit sans avocat, et que les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation refusent de régulariser.